Le travailla techniquela libert La libert estelle limite
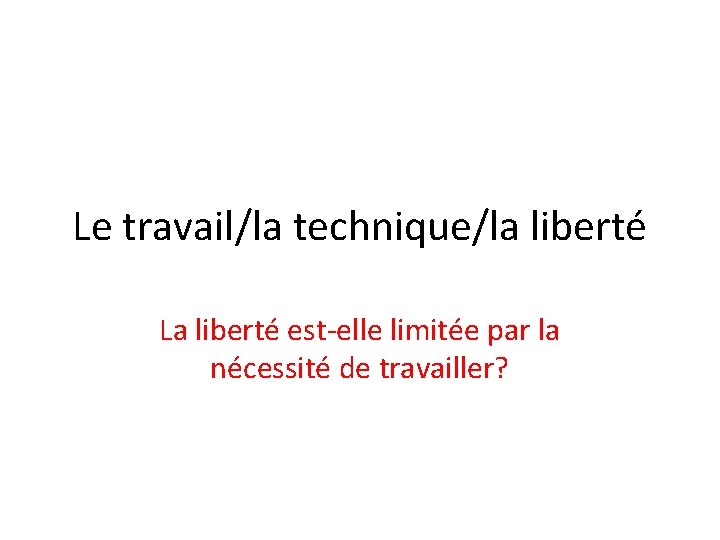
Le travail/la technique/la liberté La liberté est-elle limitée par la nécessité de travailler?
![Introduction • [Approche du sujet] Le travail est aujourd’hui une valeur incontournable de sorte Introduction • [Approche du sujet] Le travail est aujourd’hui une valeur incontournable de sorte](http://slidetodoc.com/presentation_image/5d43617aaa378d36c2d752729a90e0c3/image-2.jpg)
Introduction • [Approche du sujet] Le travail est aujourd’hui une valeur incontournable de sorte que ne pas participer à son espace nous marginalise à tous les points de vue. Un chômeur n’est pas parce qu’il ne produit pas, il ne consomme presque pas et, de surcroît, il coûte cher aux contribuables notamment dans les sociétés occidentales. Le travail nous offre une reconnaissance au-delà des « récompenses » matérielles. [Problématique] Mais cette reconnaissance ne cache-t-elle pas quelque part une liberté menacée, fragilisée ? Travailler et continuer à jouir de sa liberté semble alors improbable. Travailler ne relève apparemment pas d’un choix libre et arbitraire ; le travail fait intrinsèquement partie de la condition humaine, d’une nécessité à plusieurs niveaux. [Annonce du plan : I] Cependant, cette nécessité n’a-t-elle pas soutenu l’indépendance des hommes ? [II] Travailler pour vivre n’est-ce pas une contrainte qui me renvoie à ma finitude et qui neutralise ma liberté? [III] Ne peut-on pas néanmoins soutenir qu’aucune liberté ne se réalise sans le règne de ce qui semble s’y opposer, celui de la nécessité ?
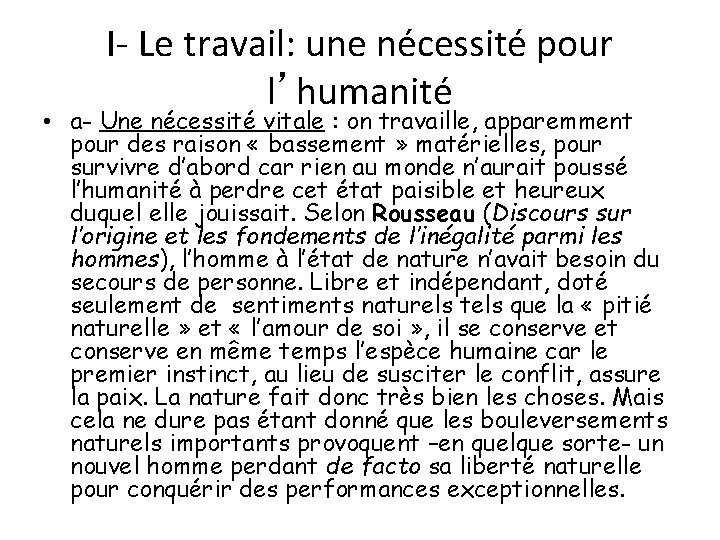
I- Le travail: une nécessité pour l’humanité • a- Une nécessité vitale : on travaille, apparemment pour des raison « bassement » matérielles, pour survivre d’abord car rien au monde n’aurait poussé l’humanité à perdre cet état paisible et heureux duquel elle jouissait. Selon Rousseau (Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes), l’homme à l’état de nature n’avait besoin du secours de personne. Libre et indépendant, doté seulement de sentiments naturels tels que la « pitié naturelle » et « l’amour de soi » , il se conserve et conserve en même temps l’espèce humaine car le premier instinct, au lieu de susciter le conflit, assure la paix. La nature fait donc très bien les choses. Mais cela ne dure pas étant donné que les bouleversements naturels importants provoquent –en quelque sorte- un nouvel homme perdant de facto sa liberté naturelle pour conquérir des performances exceptionnelles.
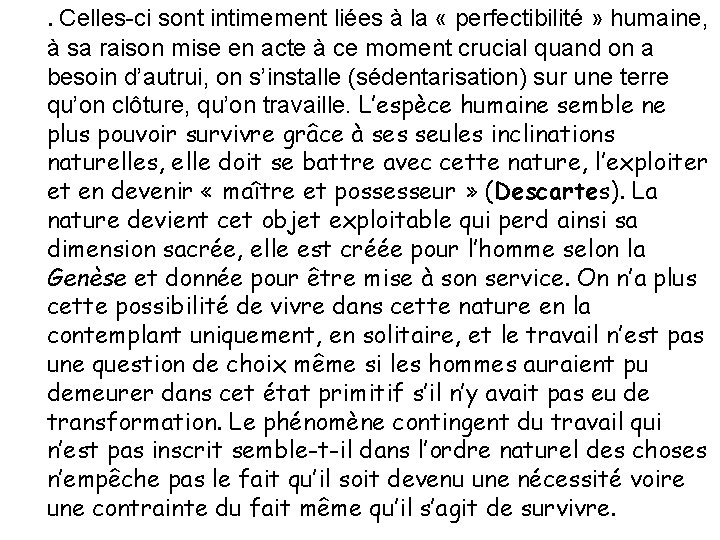
. Celles-ci sont intimement liées à la « perfectibilité » humaine, à sa raison mise en acte à ce moment crucial quand on a besoin d’autrui, on s’installe (sédentarisation) sur une terre qu’on clôture, qu’on travaille. L’espèce humaine semble ne plus pouvoir survivre grâce à ses seules inclinations naturelles, elle doit se battre avec cette nature, l’exploiter et en devenir « maître et possesseur » (Descartes). La nature devient cet objet exploitable qui perd ainsi sa dimension sacrée, elle est créée pour l’homme selon la Genèse et donnée pour être mise à son service. On n’a plus cette possibilité de vivre dans cette nature en la contemplant uniquement, en solitaire, et le travail n’est pas une question de choix même si les hommes auraient pu demeurer dans cet état primitif s’il n’y avait pas eu de transformation. Le phénomène contingent du travail qui n’est pas inscrit semble-t-il dans l’ordre naturel des choses n’empêche pas le fait qu’il soit devenu une nécessité voire une contrainte du fait même qu’il s’agit de survivre.
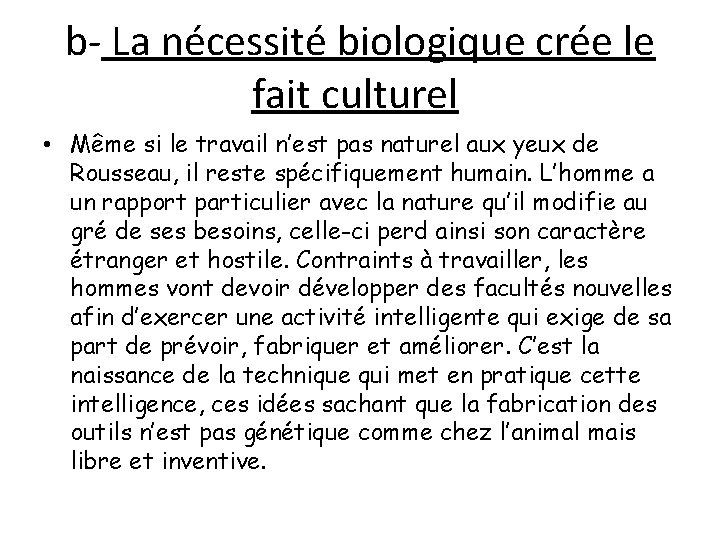
b- La nécessité biologique crée le fait culturel • Même si le travail n’est pas naturel aux yeux de Rousseau, il reste spécifiquement humain. L’homme a un rapport particulier avec la nature qu’il modifie au gré de ses besoins, celle-ci perd ainsi son caractère étranger et hostile. Contraints à travailler, les hommes vont devoir développer des facultés nouvelles afin d’exercer une activité intelligente qui exige de sa part de prévoir, fabriquer et améliorer. C’est la naissance de la technique qui met en pratique cette intelligence, ces idées sachant que la fabrication des outils n’est pas génétique comme chez l’animal mais libre et inventive.
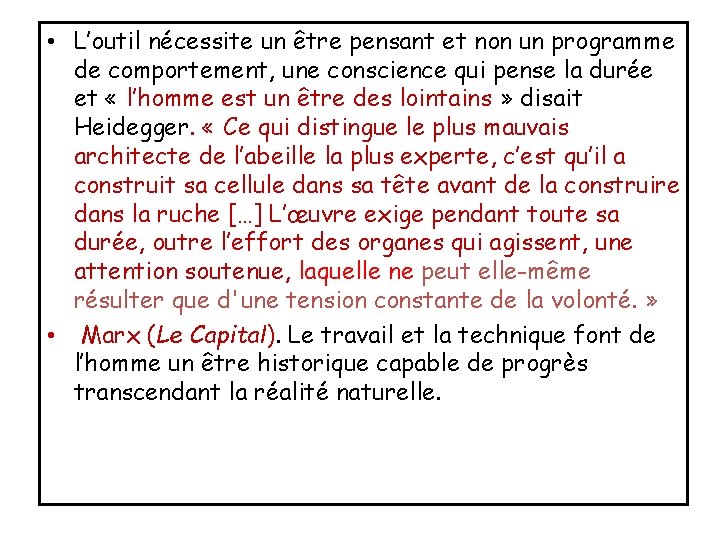
• L’outil nécessite un être pensant et non un programme de comportement, une conscience qui pense la durée et « l’homme est un être des lointains » disait Heidegger. « Ce qui distingue le plus mauvais architecte de l’abeille la plus experte, c’est qu’il a construit sa cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche […] L’œuvre exige pendant toute sa durée, outre l’effort des organes qui agissent, une attention soutenue, laquelle ne peut elle-même résulter que d'une tension constante de la volonté. » • Marx (Le Capital). Le travail et la technique font de l’homme un être historique capable de progrès transcendant la réalité naturelle.
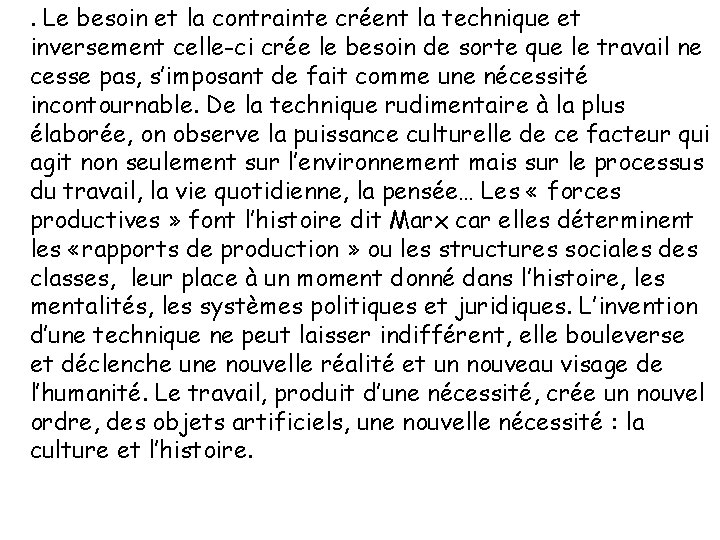
. Le besoin et la contrainte créent la technique et inversement celle-ci crée le besoin de sorte que le travail ne cesse pas, s’imposant de fait comme une nécessité incontournable. De la technique rudimentaire à la plus élaborée, on observe la puissance culturelle de ce facteur qui agit non seulement sur l’environnement mais sur le processus du travail, la vie quotidienne, la pensée… Les « forces productives » font l’histoire dit Marx car elles déterminent les «rapports de production » ou les structures sociales des classes, leur place à un moment donné dans l’histoire, les mentalités, les systèmes politiques et juridiques. L’invention d’une technique ne peut laisser indifférent, elle bouleverse et déclenche une nouvelle réalité et un nouveau visage de l’humanité. Le travail, produit d’une nécessité, crée un nouvel ordre, des objets artificiels, une nouvelle nécessité : la culture et l’histoire.
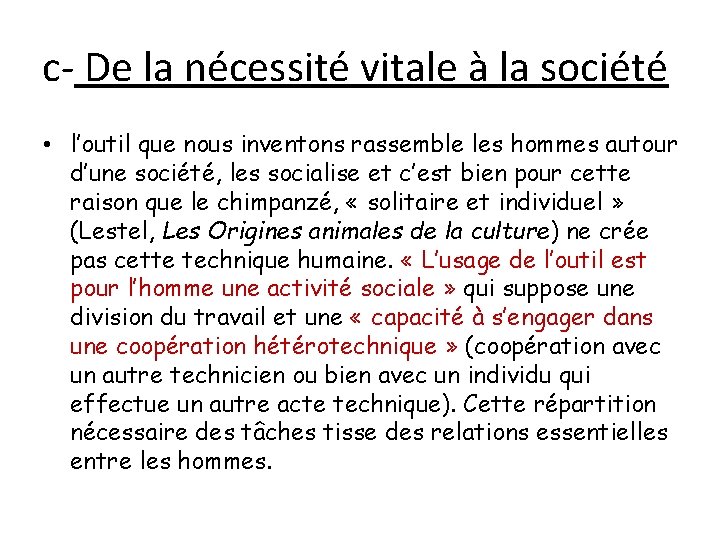
c- De la nécessité vitale à la société • l’outil que nous inventons rassemble les hommes autour d’une société, les socialise et c’est bien pour cette raison que le chimpanzé, « solitaire et individuel » (Lestel, Les Origines animales de la culture) ne crée pas cette technique humaine. « L’usage de l’outil est pour l’homme une activité sociale » qui suppose une division du travail et une « capacité à s’engager dans une coopération hétérotechnique » (coopération avec un autre technicien ou bien avec un individu qui effectue un autre acte technique). Cette répartition nécessaire des tâches tisse des relations essentielles entre les hommes.
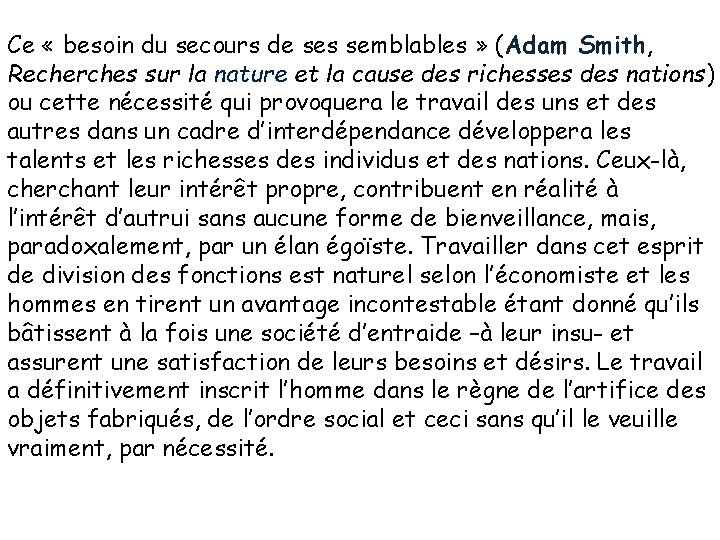
Ce « besoin du secours de ses semblables » (Adam Smith, Recherches sur la nature et la cause des richesses des nations) ou cette nécessité qui provoquera le travail des uns et des autres dans un cadre d’interdépendance développera les talents et les richesses des individus et des nations. Ceux-là, cherchant leur intérêt propre, contribuent en réalité à l’intérêt d’autrui sans aucune forme de bienveillance, mais, paradoxalement, par un élan égoïste. Travailler dans cet esprit de division des fonctions est naturel selon l’économiste et les hommes en tirent un avantage incontestable étant donné qu’ils bâtissent à la fois une société d’entraide –à leur insu- et assurent une satisfaction de leurs besoins et désirs. Le travail a définitivement inscrit l’homme dans le règne de l’artifice des objets fabriqués, de l’ordre social et ceci sans qu’il le veuille vraiment, par nécessité.
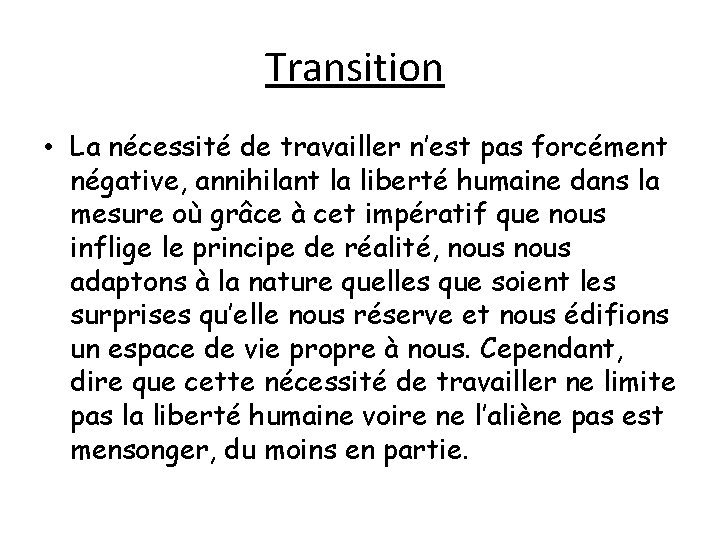
Transition • La nécessité de travailler n’est pas forcément négative, annihilant la liberté humaine dans la mesure où grâce à cet impératif que nous inflige le principe de réalité, nous adaptons à la nature quelles que soient les surprises qu’elle nous réserve et nous édifions un espace de vie propre à nous. Cependant, dire que cette nécessité de travailler ne limite pas la liberté humaine voire ne l’aliène pas est mensonger, du moins en partie.
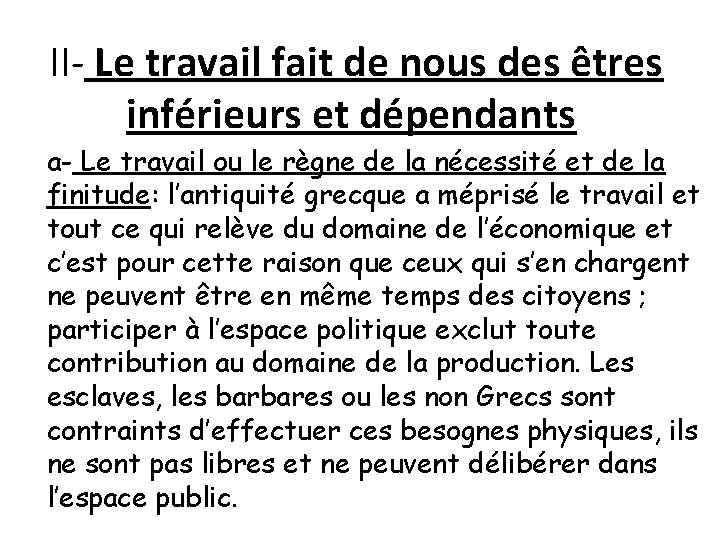
II- Le travail fait de nous des êtres inférieurs et dépendants a- Le travail ou le règne de la nécessité et de la finitude: l’antiquité grecque a méprisé le travail et tout ce qui relève du domaine de l’économique et c’est pour cette raison que ceux qui s’en chargent ne peuvent être en même temps des citoyens ; participer à l’espace politique exclut toute contribution au domaine de la production. Les esclaves, les barbares ou les non Grecs sont contraints d’effectuer ces besognes physiques, ils ne sont pas libres et ne peuvent délibérer dans l’espace public.
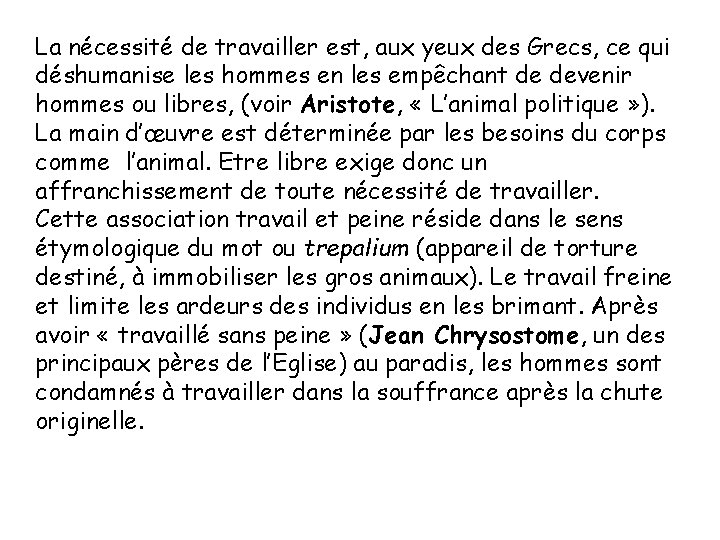
La nécessité de travailler est, aux yeux des Grecs, ce qui déshumanise les hommes en les empêchant de devenir hommes ou libres, (voir Aristote, « L’animal politique » ). La main d’œuvre est déterminée par les besoins du corps comme l’animal. Etre libre exige donc un affranchissement de toute nécessité de travailler. Cette association travail et peine réside dans le sens étymologique du mot ou trepalium (appareil de torture destiné, à immobiliser les gros animaux). Le travail freine et limite les ardeurs des individus en les brimant. Après avoir « travaillé sans peine » (Jean Chrysostome, un des principaux pères de l’Eglise) au paradis, les hommes sont condamnés à travailler dans la souffrance après la chute originelle.
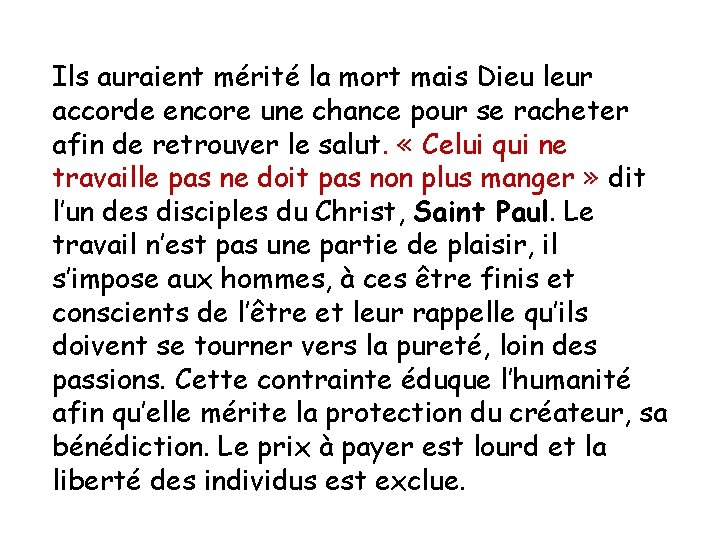
Ils auraient mérité la mort mais Dieu leur accorde encore une chance pour se racheter afin de retrouver le salut. « Celui qui ne travaille pas ne doit pas non plus manger » dit l’un des disciples du Christ, Saint Paul. Le travail n’est pas une partie de plaisir, il s’impose aux hommes, à ces être finis et conscients de l’être et leur rappelle qu’ils doivent se tourner vers la pureté, loin des passions. Cette contrainte éduque l’humanité afin qu’elle mérite la protection du créateur, sa bénédiction. Le prix à payer est lourd et la liberté des individus est exclue.
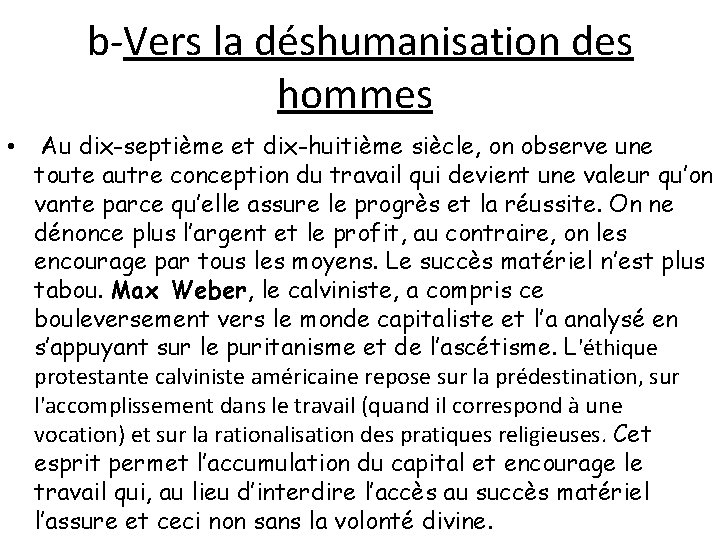
b-Vers la déshumanisation des hommes • Au dix-septième et dix-huitième siècle, on observe une toute autre conception du travail qui devient une valeur qu’on vante parce qu’elle assure le progrès et la réussite. On ne dénonce plus l’argent et le profit, au contraire, on les encourage par tous les moyens. Le succès matériel n’est plus tabou. Max Weber, le calviniste, a compris ce bouleversement vers le monde capitaliste et l’a analysé en s’appuyant sur le puritanisme et de l’ascétisme. L'éthique protestante calviniste américaine repose sur la prédestination, sur l'accomplissement dans le travail (quand il correspond à une vocation) et sur la rationalisation des pratiques religieuses. Cet esprit permet l’accumulation du capital et encourage le travail qui, au lieu d’interdire l’accès au succès matériel l’assure et ceci non sans la volonté divine.
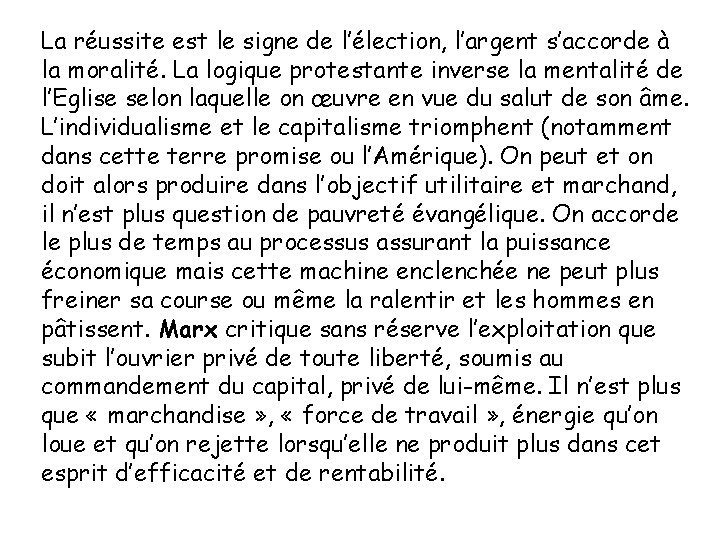
La réussite est le signe de l’élection, l’argent s’accorde à la moralité. La logique protestante inverse la mentalité de l’Eglise selon laquelle on œuvre en vue du salut de son âme. L’individualisme et le capitalisme triomphent (notamment dans cette terre promise ou l’Amérique). On peut et on doit alors produire dans l’objectif utilitaire et marchand, il n’est plus question de pauvreté évangélique. On accorde le plus de temps au processus assurant la puissance économique mais cette machine enclenchée ne peut plus freiner sa course ou même la ralentir et les hommes en pâtissent. Marx critique sans réserve l’exploitation que subit l’ouvrier privé de toute liberté, soumis au commandement du capital, privé de lui-même. Il n’est plus que « marchandise » , « force de travail » , énergie qu’on loue et qu’on rejette lorsqu’elle ne produit plus dans cet esprit d’efficacité et de rentabilité.
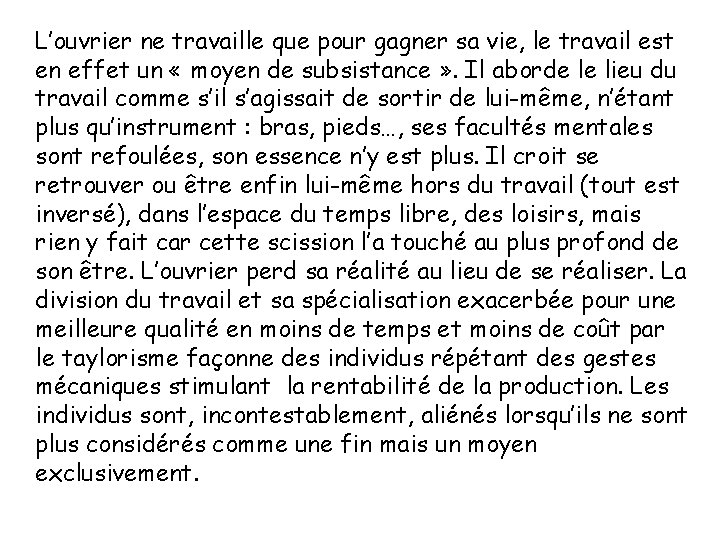
L’ouvrier ne travaille que pour gagner sa vie, le travail est en effet un « moyen de subsistance » . Il aborde le lieu du travail comme s’il s’agissait de sortir de lui-même, n’étant plus qu’instrument : bras, pieds…, ses facultés mentales sont refoulées, son essence n’y est plus. Il croit se retrouver ou être enfin lui-même hors du travail (tout est inversé), dans l’espace du temps libre, des loisirs, mais rien y fait car cette scission l’a touché au plus profond de son être. L’ouvrier perd sa réalité au lieu de se réaliser. La division du travail et sa spécialisation exacerbée pour une meilleure qualité en moins de temps et moins de coût par le taylorisme façonne des individus répétant des gestes mécaniques stimulant la rentabilité de la production. Les individus sont, incontestablement, aliénés lorsqu’ils ne sont plus considérés comme une fin mais un moyen exclusivement.
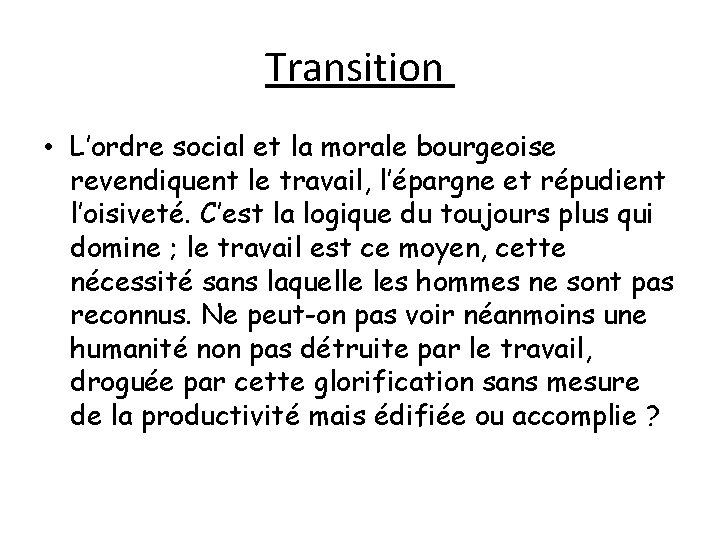
Transition • L’ordre social et la morale bourgeoise revendiquent le travail, l’épargne et répudient l’oisiveté. C’est la logique du toujours plus qui domine ; le travail est ce moyen, cette nécessité sans laquelle les hommes ne sont pas reconnus. Ne peut-on pas voir néanmoins une humanité non pas détruite par le travail, droguée par cette glorification sans mesure de la productivité mais édifiée ou accomplie ?
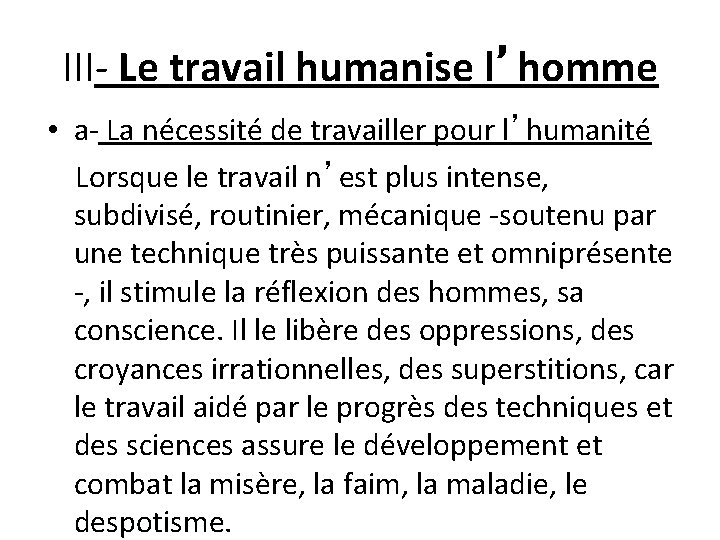
III- Le travail humanise l’homme • a- La nécessité de travailler pour l’humanité Lorsque le travail n’est plus intense, subdivisé, routinier, mécanique -soutenu par une technique très puissante et omniprésente -, il stimule la réflexion des hommes, sa conscience. Il le libère des oppressions, des croyances irrationnelles, des superstitions, car le travail aidé par le progrès des techniques et des sciences assure le développement et combat la misère, la faim, la maladie, le despotisme.
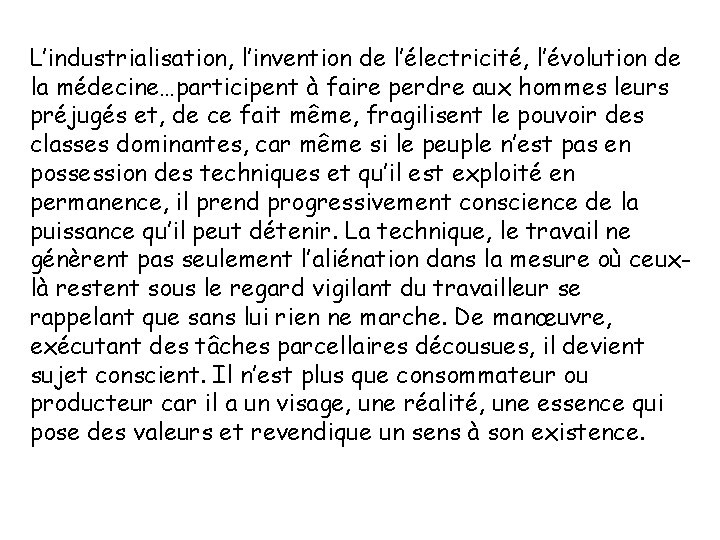
L’industrialisation, l’invention de l’électricité, l’évolution de la médecine…participent à faire perdre aux hommes leurs préjugés et, de ce fait même, fragilisent le pouvoir des classes dominantes, car même si le peuple n’est pas en possession des techniques et qu’il est exploité en permanence, il prend progressivement conscience de la puissance qu’il peut détenir. La technique, le travail ne génèrent pas seulement l’aliénation dans la mesure où ceuxlà restent sous le regard vigilant du travailleur se rappelant que sans lui rien ne marche. De manœuvre, exécutant des tâches parcellaires décousues, il devient sujet conscient. Il n’est plus que consommateur ou producteur car il a un visage, une réalité, une essence qui pose des valeurs et revendique un sens à son existence.
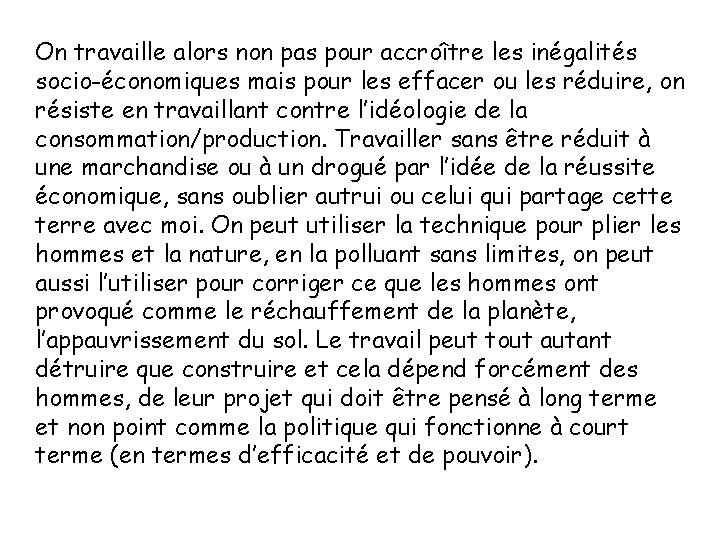
On travaille alors non pas pour accroître les inégalités socio-économiques mais pour les effacer ou les réduire, on résiste en travaillant contre l’idéologie de la consommation/production. Travailler sans être réduit à une marchandise ou à un drogué par l’idée de la réussite économique, sans oublier autrui ou celui qui partage cette terre avec moi. On peut utiliser la technique pour plier les hommes et la nature, en la polluant sans limites, on peut aussi l’utiliser pour corriger ce que les hommes ont provoqué comme le réchauffement de la planète, l’appauvrissement du sol. Le travail peut tout autant détruire que construire et cela dépend forcément des hommes, de leur projet qui doit être pensé à long terme et non point comme la politique qui fonctionne à court terme (en termes d’efficacité et de pouvoir).
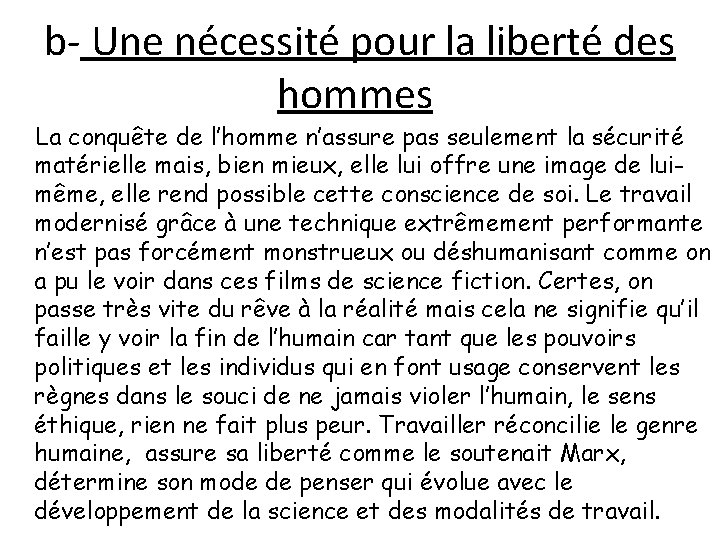
b- Une nécessité pour la liberté des hommes La conquête de l’homme n’assure pas seulement la sécurité matérielle mais, bien mieux, elle lui offre une image de luimême, elle rend possible cette conscience de soi. Le travail modernisé grâce à une technique extrêmement performante n’est pas forcément monstrueux ou déshumanisant comme on a pu le voir dans ces films de science fiction. Certes, on passe très vite du rêve à la réalité mais cela ne signifie qu’il faille y voir la fin de l’humain car tant que les pouvoirs politiques et les individus qui en font usage conservent les règnes dans le souci de ne jamais violer l’humain, le sens éthique, rien ne fait plus peur. Travailler réconcilie le genre humaine, assure sa liberté comme le soutenait Marx, détermine son mode de penser qui évolue avec le développement de la science et des modalités de travail.
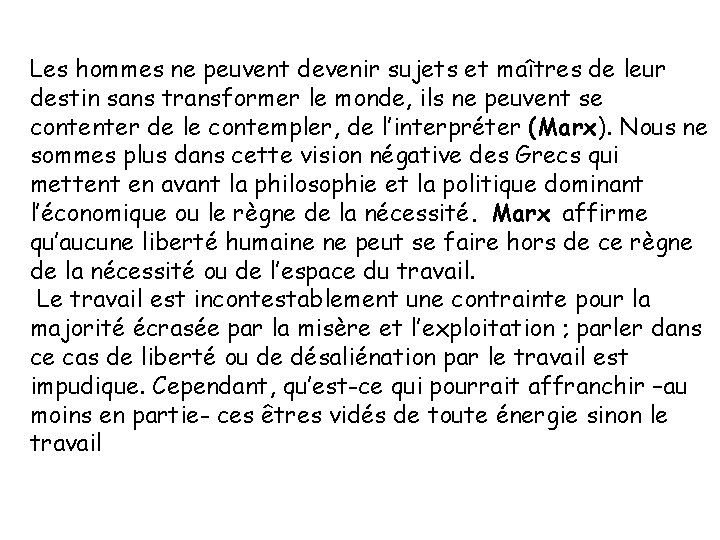
Les hommes ne peuvent devenir sujets et maîtres de leur destin sans transformer le monde, ils ne peuvent se contenter de le contempler, de l’interpréter (Marx). Nous ne sommes plus dans cette vision négative des Grecs qui mettent en avant la philosophie et la politique dominant l’économique ou le règne de la nécessité. Marx affirme qu’aucune liberté humaine ne peut se faire hors de ce règne de la nécessité ou de l’espace du travail. Le travail est incontestablement une contrainte pour la majorité écrasée par la misère et l’exploitation ; parler dans ce cas de liberté ou de désaliénation par le travail est impudique. Cependant, qu’est-ce qui pourrait affranchir –au moins en partie- ces êtres vidés de toute énergie sinon le travail
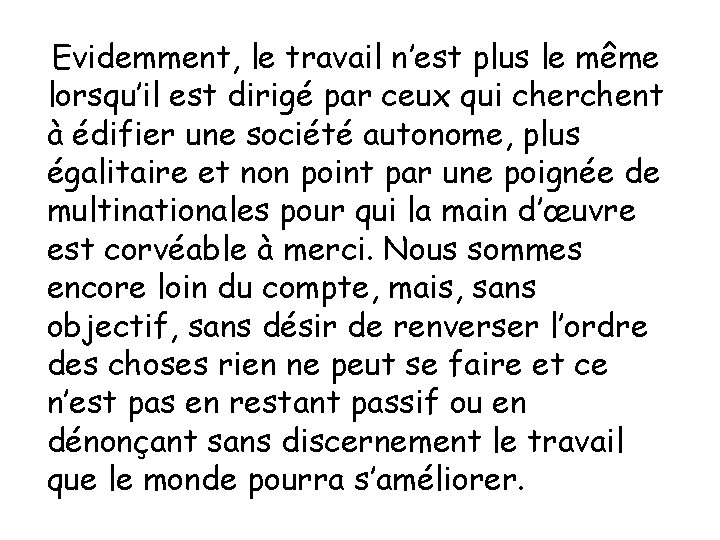
Evidemment, le travail n’est plus le même lorsqu’il est dirigé par ceux qui cherchent à édifier une société autonome, plus égalitaire et non point par une poignée de multinationales pour qui la main d’œuvre est corvéable à merci. Nous sommes encore loin du compte, mais, sans objectif, sans désir de renverser l’ordre des choses rien ne peut se faire et ce n’est pas en restant passif ou en dénonçant sans discernement le travail que le monde pourra s’améliorer.
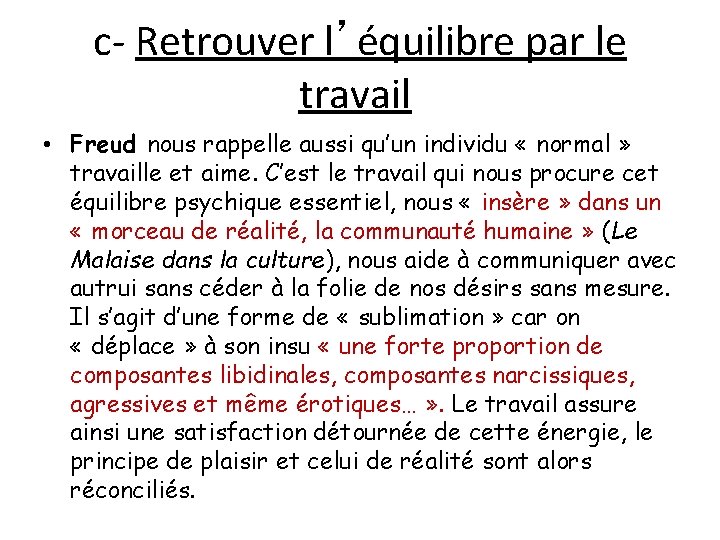
c- Retrouver l’équilibre par le travail • Freud nous rappelle aussi qu’un individu « normal » travaille et aime. C’est le travail qui nous procure cet équilibre psychique essentiel, nous « insère » dans un « morceau de réalité, la communauté humaine » (Le Malaise dans la culture), nous aide à communiquer avec autrui sans céder à la folie de nos désirs sans mesure. Il s’agit d’une forme de « sublimation » car on « déplace » à son insu « une forte proportion de composantes libidinales, composantes narcissiques, agressives et même érotiques… » . Le travail assure ainsi une satisfaction détournée de cette énergie, le principe de plaisir et celui de réalité sont alors réconciliés.
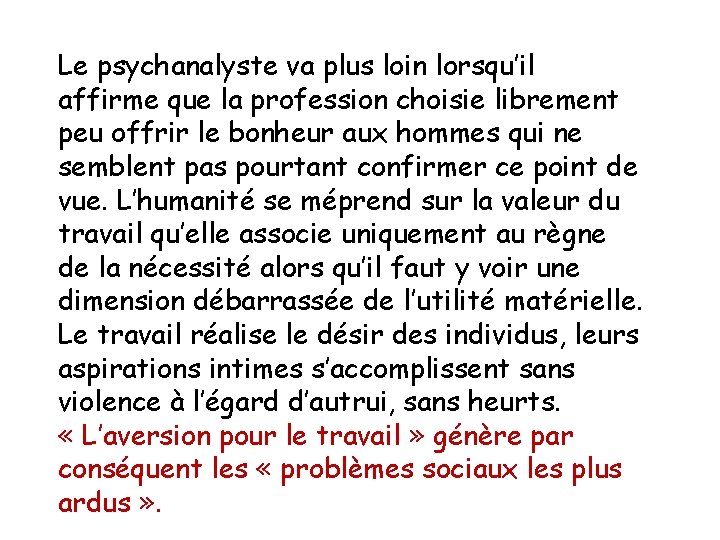
Le psychanalyste va plus loin lorsqu’il affirme que la profession choisie librement peu offrir le bonheur aux hommes qui ne semblent pas pourtant confirmer ce point de vue. L’humanité se méprend sur la valeur du travail qu’elle associe uniquement au règne de la nécessité alors qu’il faut y voir une dimension débarrassée de l’utilité matérielle. Le travail réalise le désir des individus, leurs aspirations intimes s’accomplissent sans violence à l’égard d’autrui, sans heurts. « L’aversion pour le travail » génère par conséquent les « problèmes sociaux les plus ardus » .
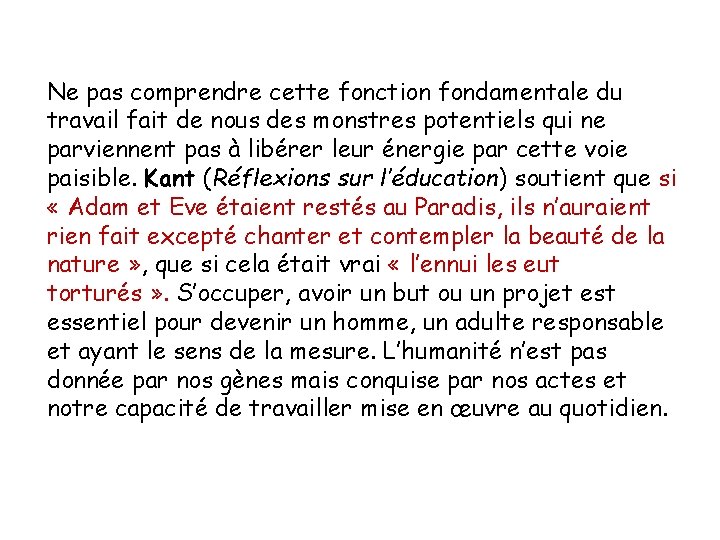
Ne pas comprendre cette fonction fondamentale du travail fait de nous des monstres potentiels qui ne parviennent pas à libérer leur énergie par cette voie paisible. Kant (Réflexions sur l’éducation) soutient que si « Adam et Eve étaient restés au Paradis, ils n’auraient rien fait excepté chanter et contempler la beauté de la nature » , que si cela était vrai « l’ennui les eut torturés » . S’occuper, avoir un but ou un projet essentiel pour devenir un homme, un adulte responsable et ayant le sens de la mesure. L’humanité n’est pas donnée par nos gènes mais conquise par nos actes et notre capacité de travailler mise en œuvre au quotidien.
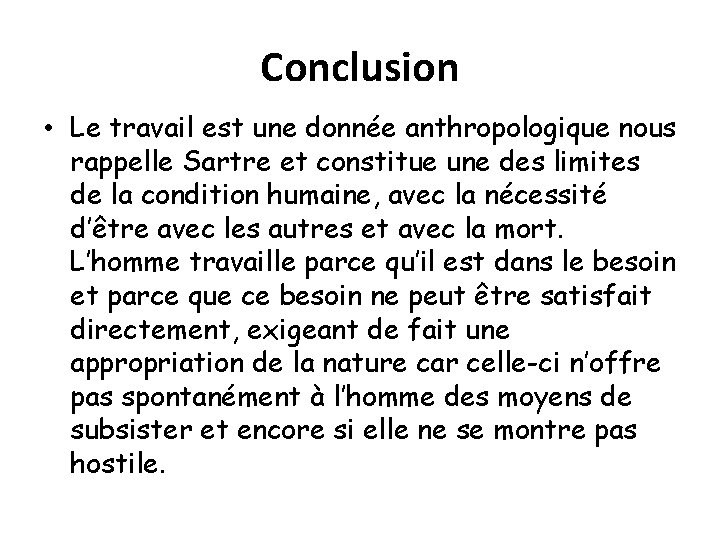
Conclusion • Le travail est une donnée anthropologique nous rappelle Sartre et constitue une des limites de la condition humaine, avec la nécessité d’être avec les autres et avec la mort. L’homme travaille parce qu’il est dans le besoin et parce que ce besoin ne peut être satisfait directement, exigeant de fait une appropriation de la nature car celle-ci n’offre pas spontanément à l’homme des moyens de subsister et encore si elle ne se montre pas hostile.
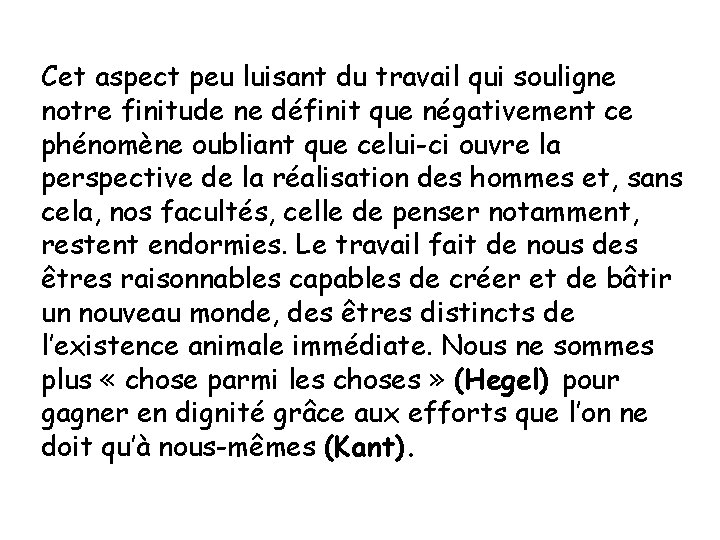
Cet aspect peu luisant du travail qui souligne notre finitude ne définit que négativement ce phénomène oubliant que celui-ci ouvre la perspective de la réalisation des hommes et, sans cela, nos facultés, celle de penser notamment, restent endormies. Le travail fait de nous des êtres raisonnables capables de créer et de bâtir un nouveau monde, des êtres distincts de l’existence animale immédiate. Nous ne sommes plus « chose parmi les choses » (Hegel) pour gagner en dignité grâce aux efforts que l’on ne doit qu’à nous-mêmes (Kant).

- Slides: 29