Le jeu discursif du strotypage et du paradoxe
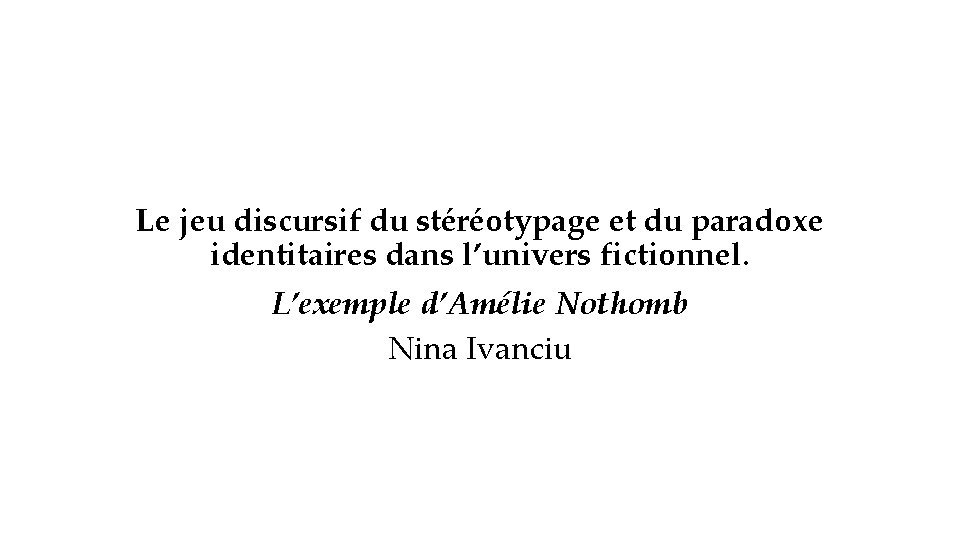
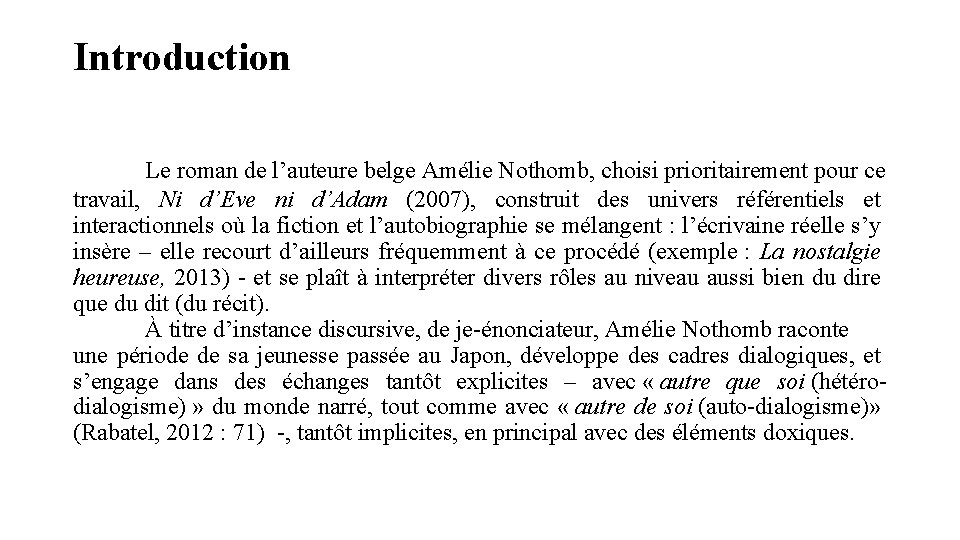
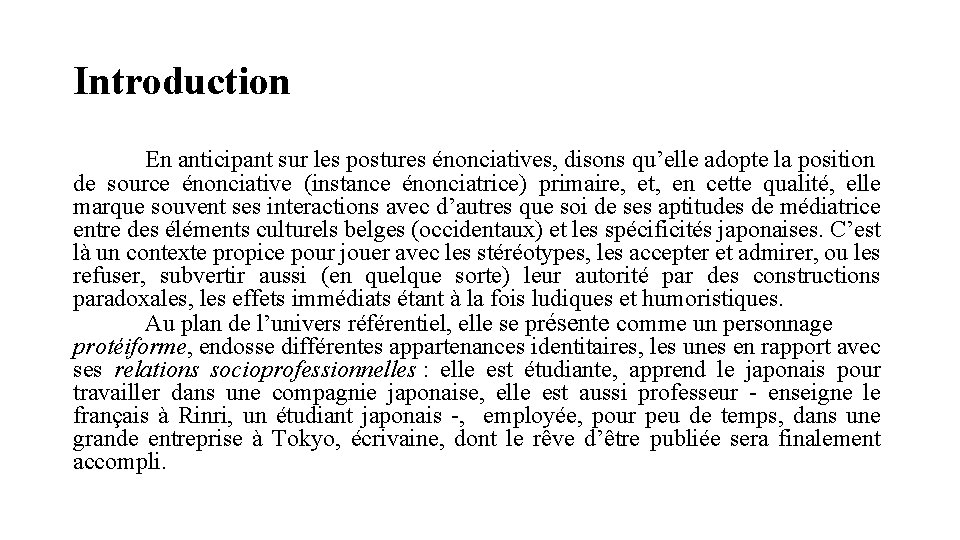
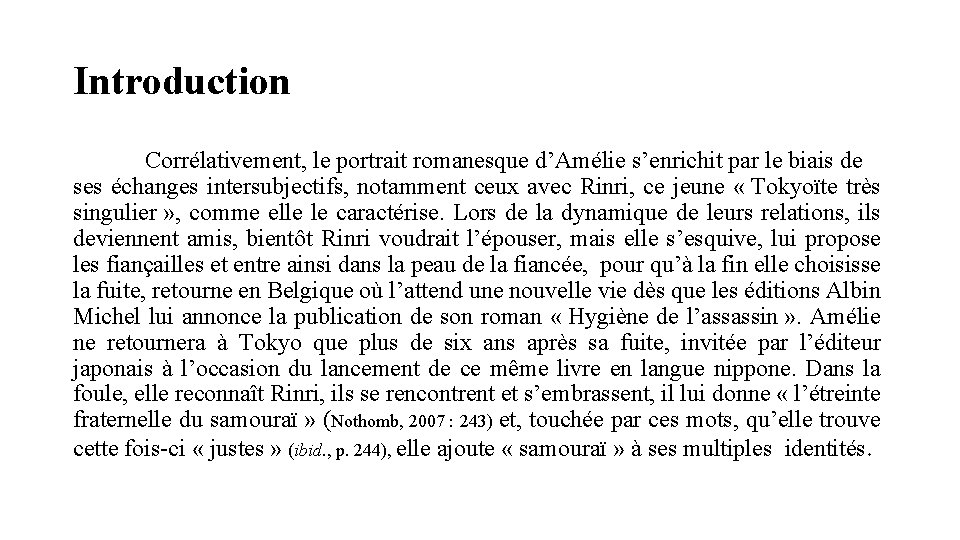
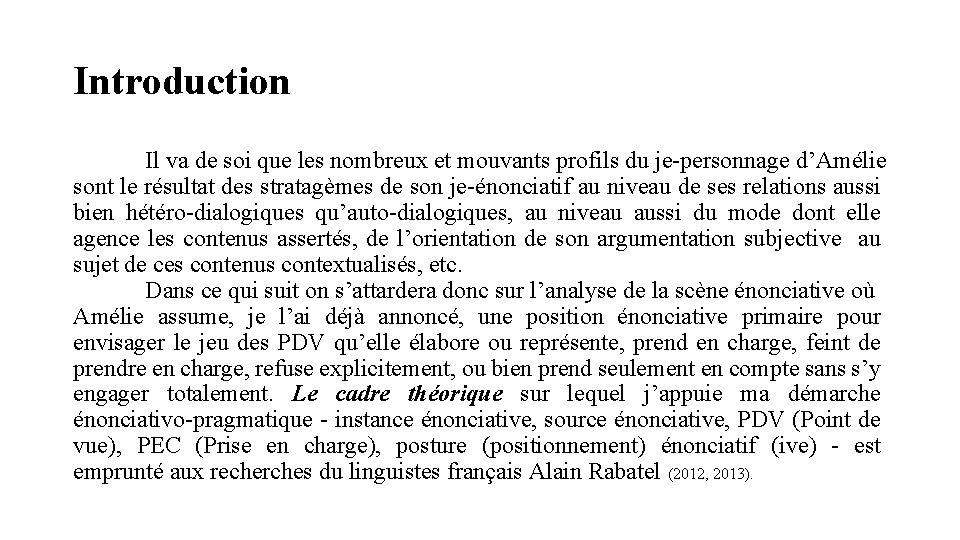
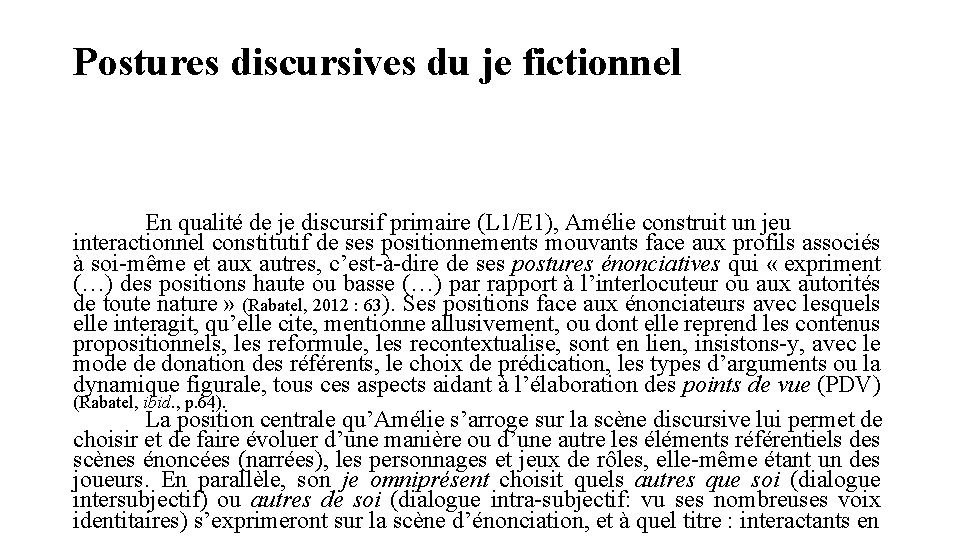
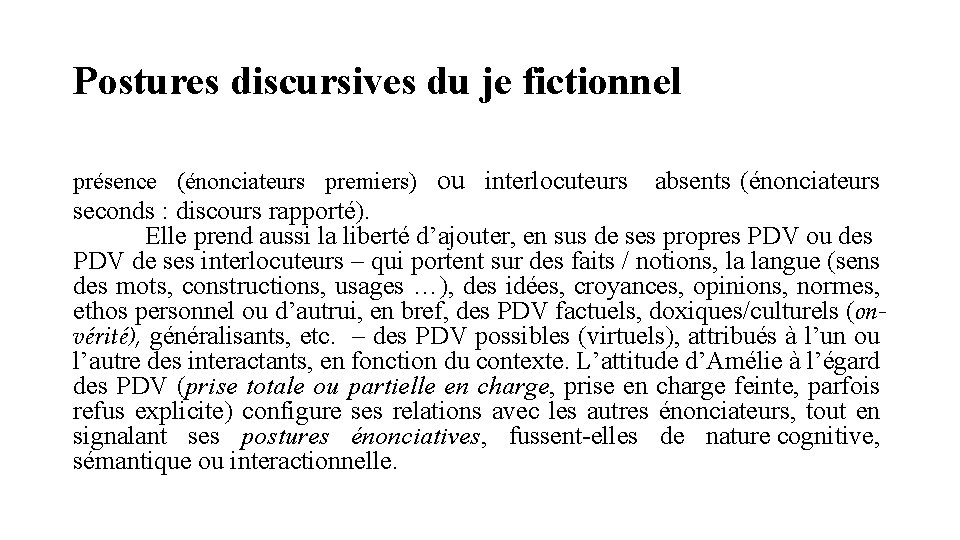
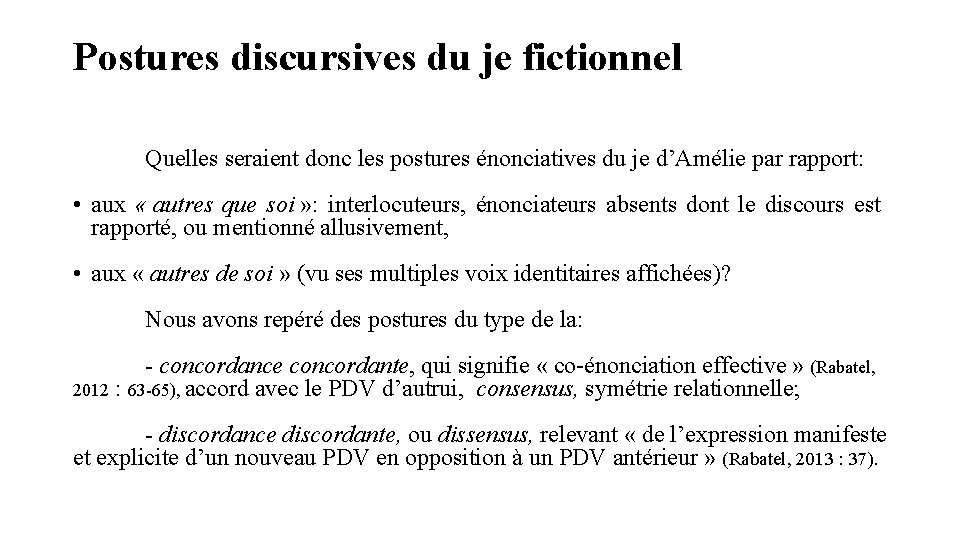
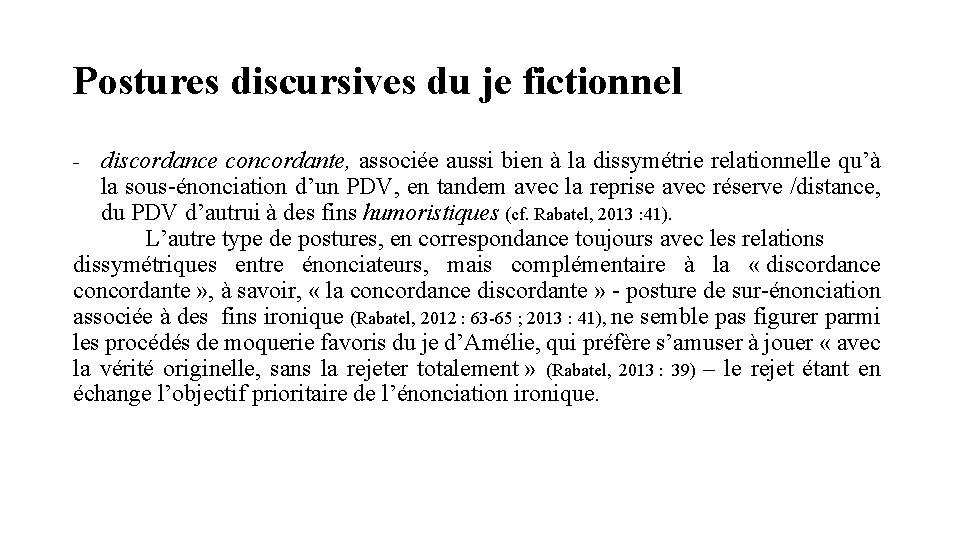
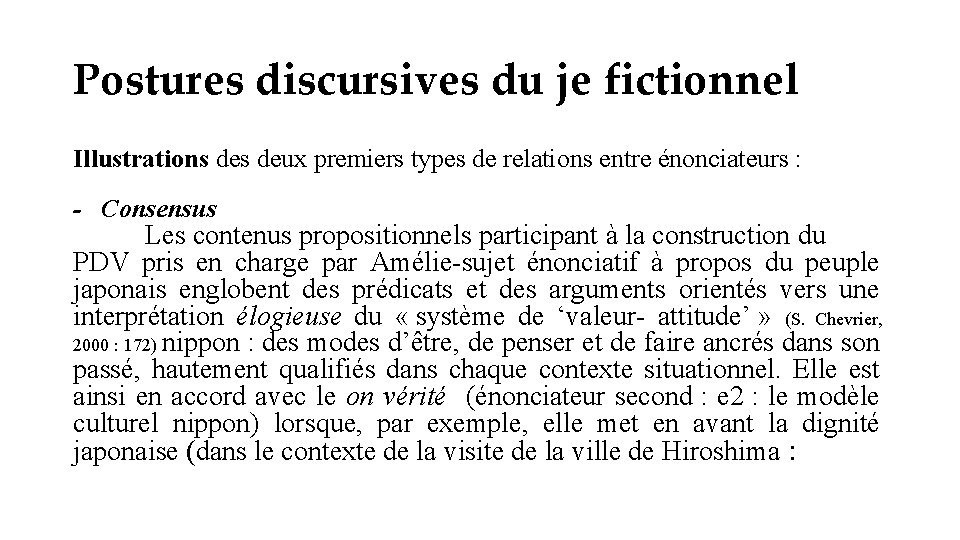
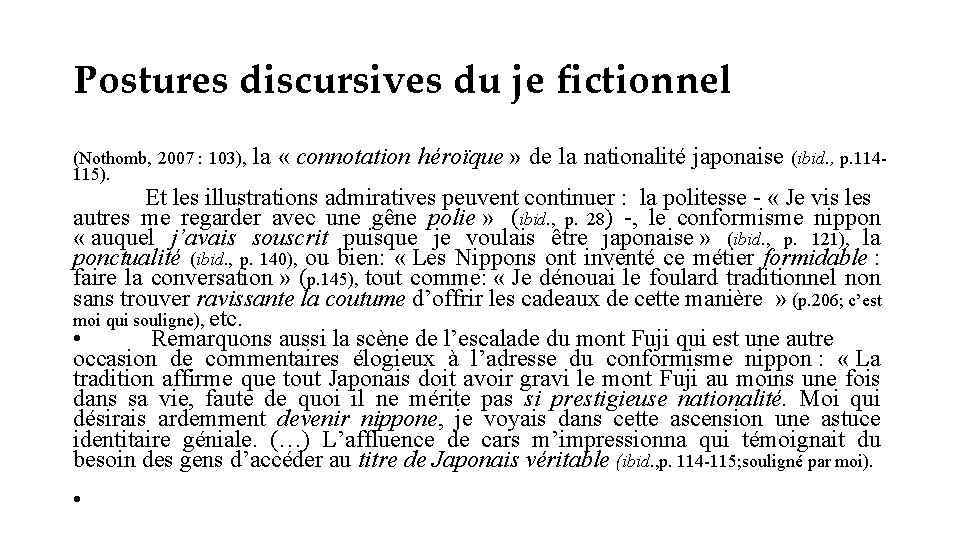
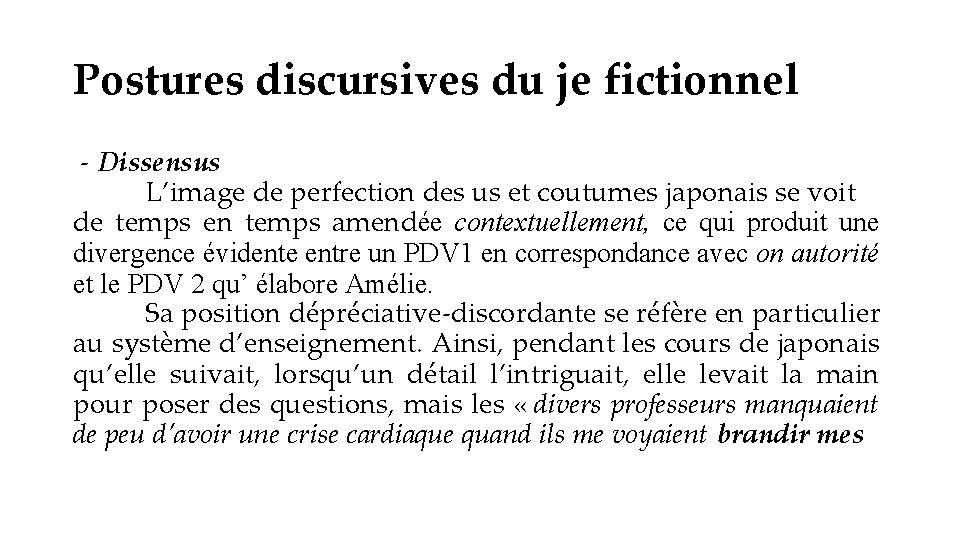
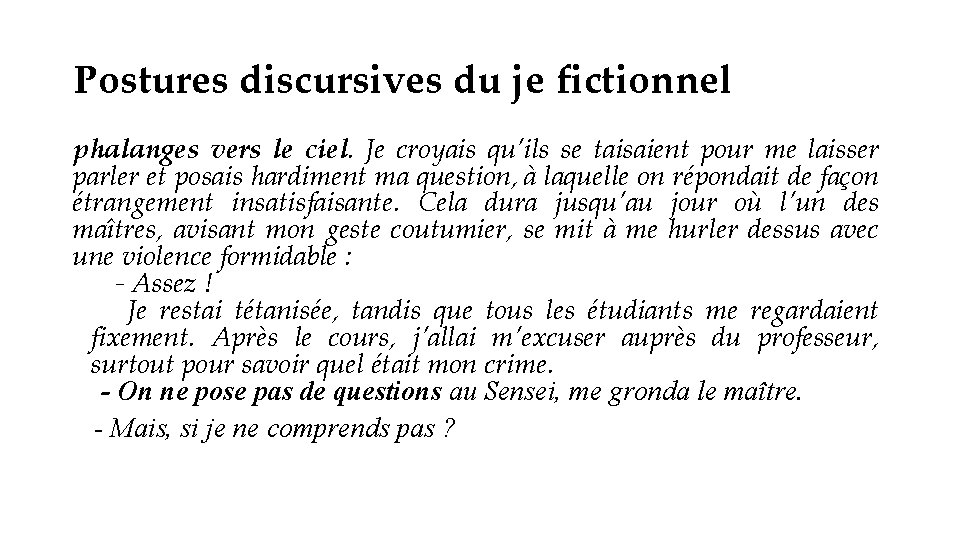
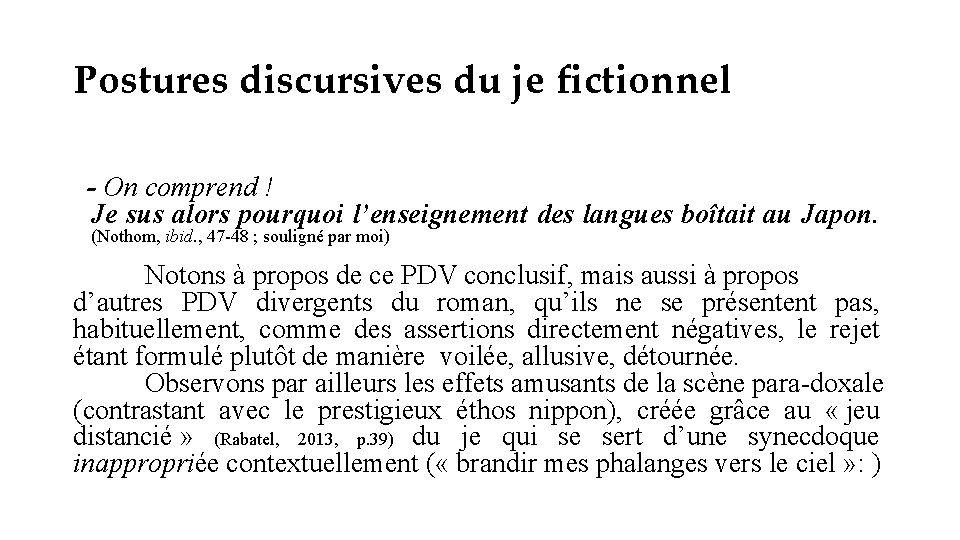
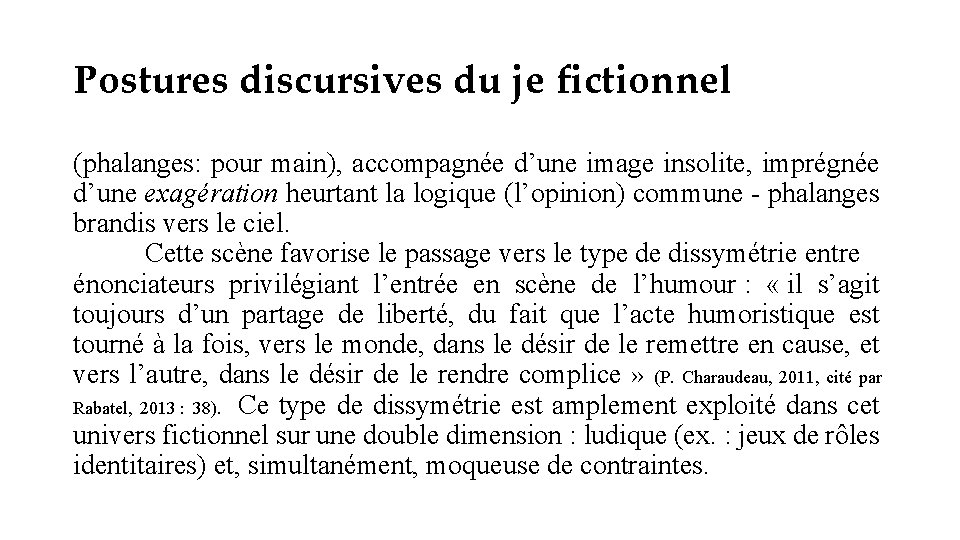
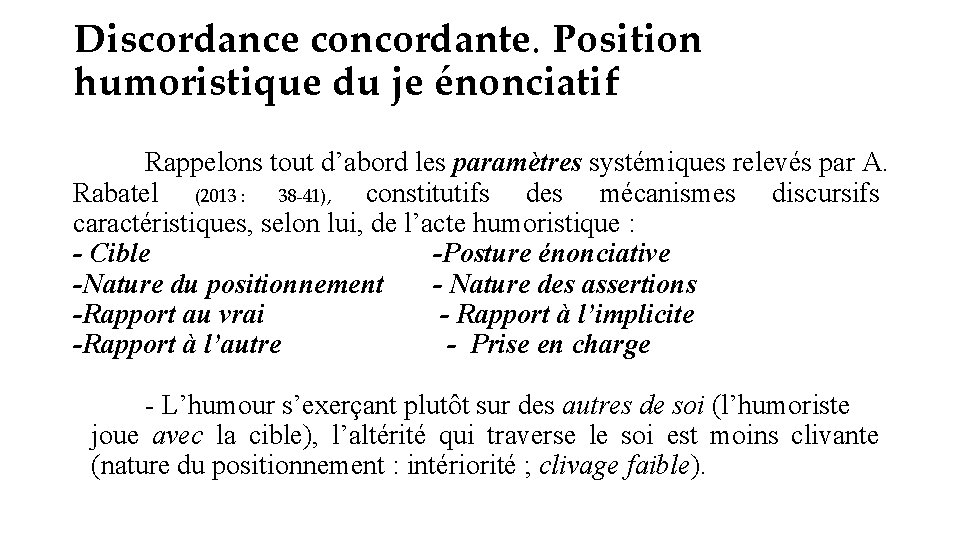
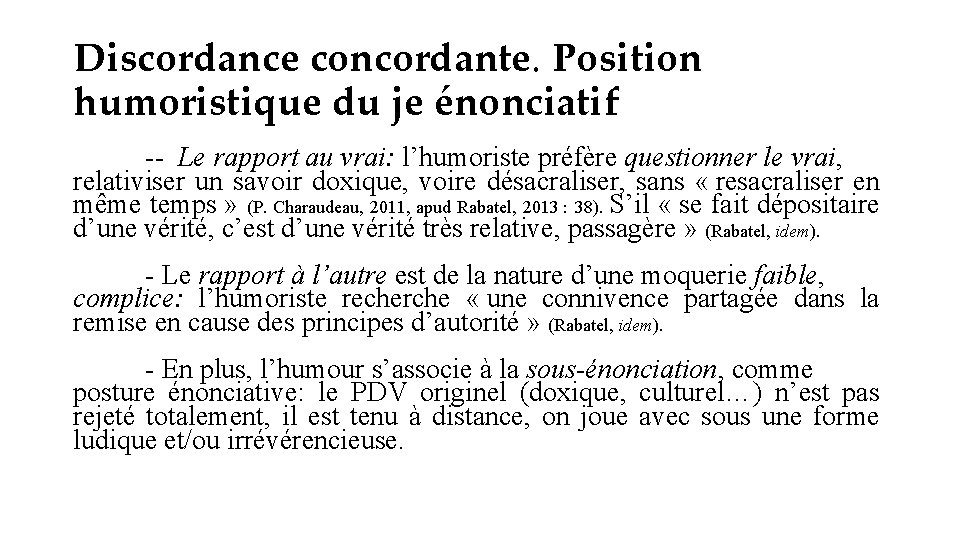
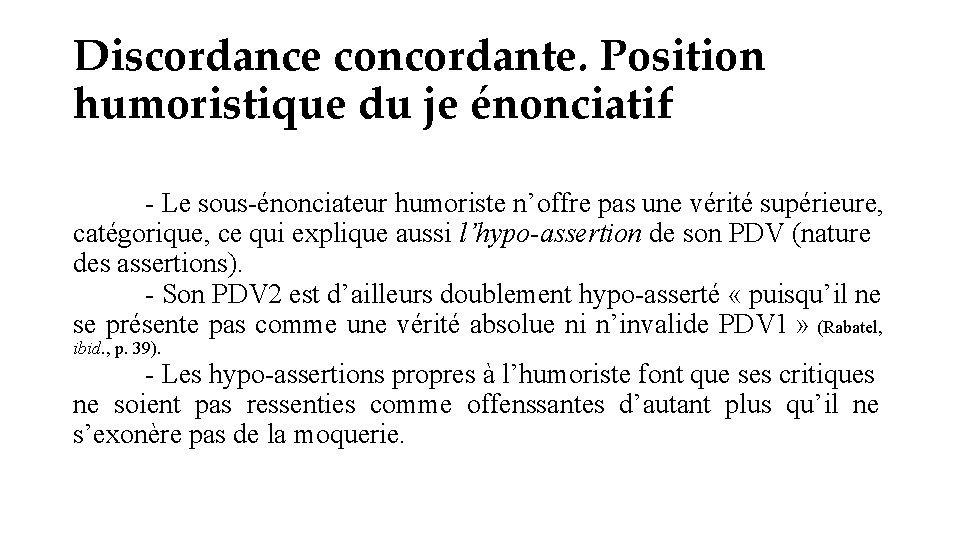
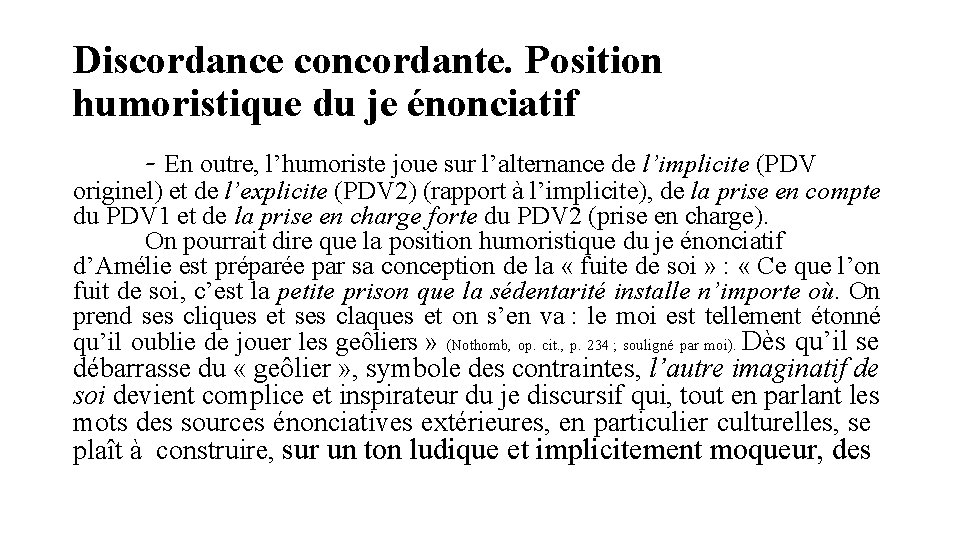
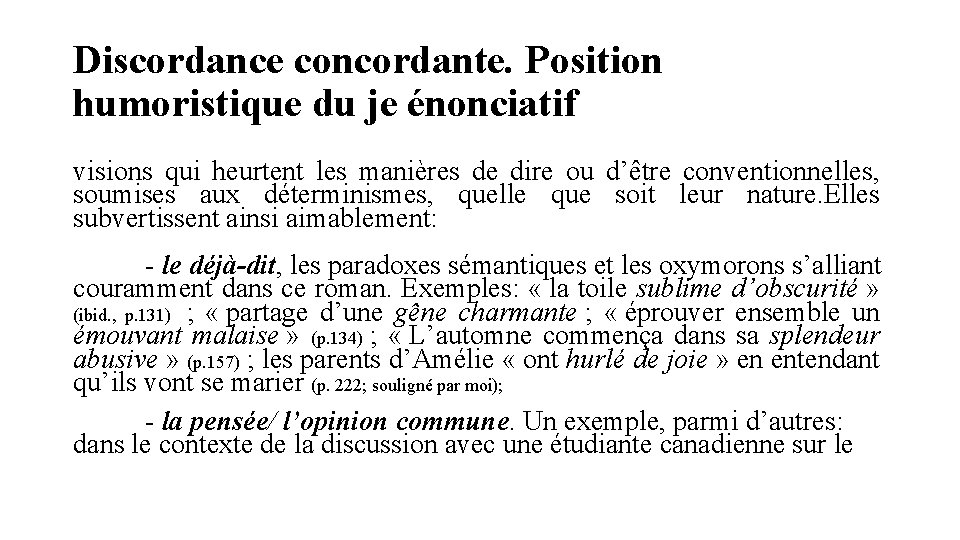
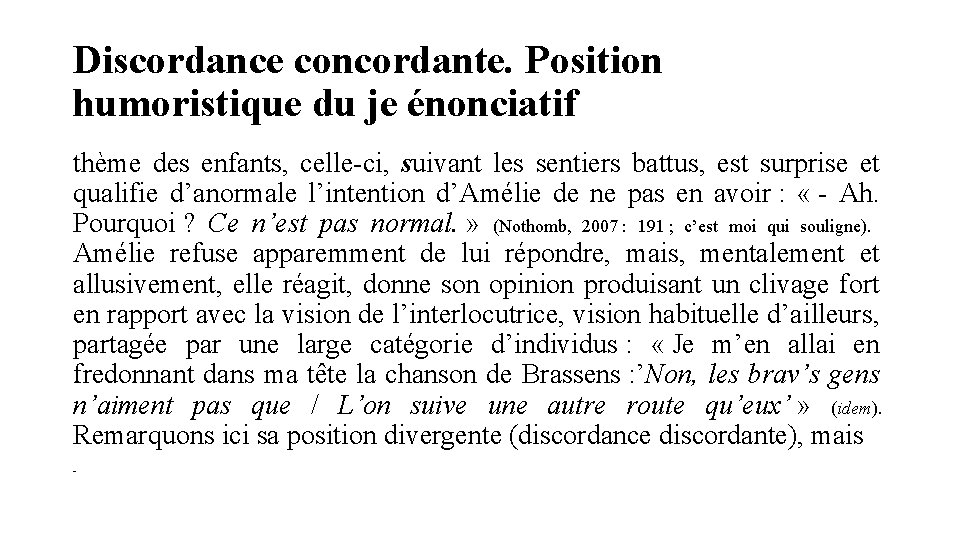
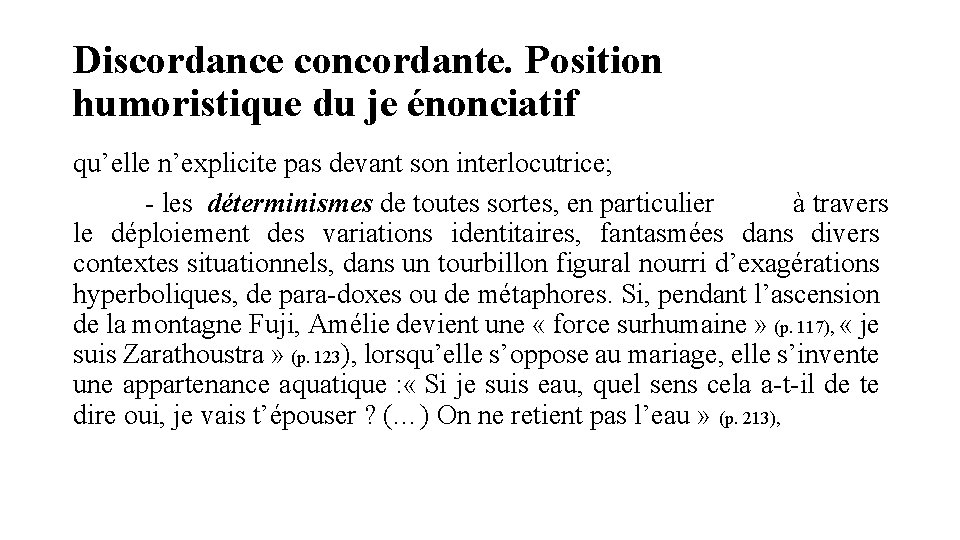
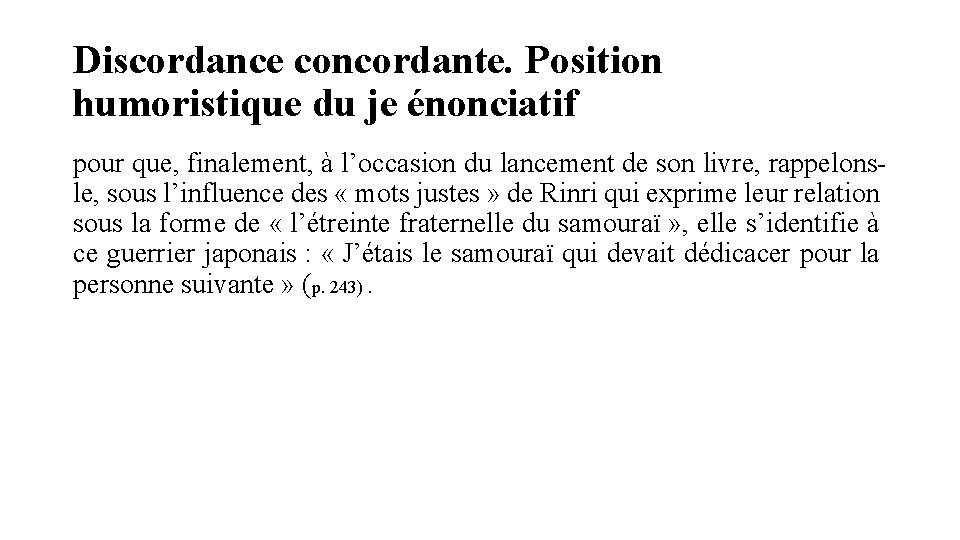
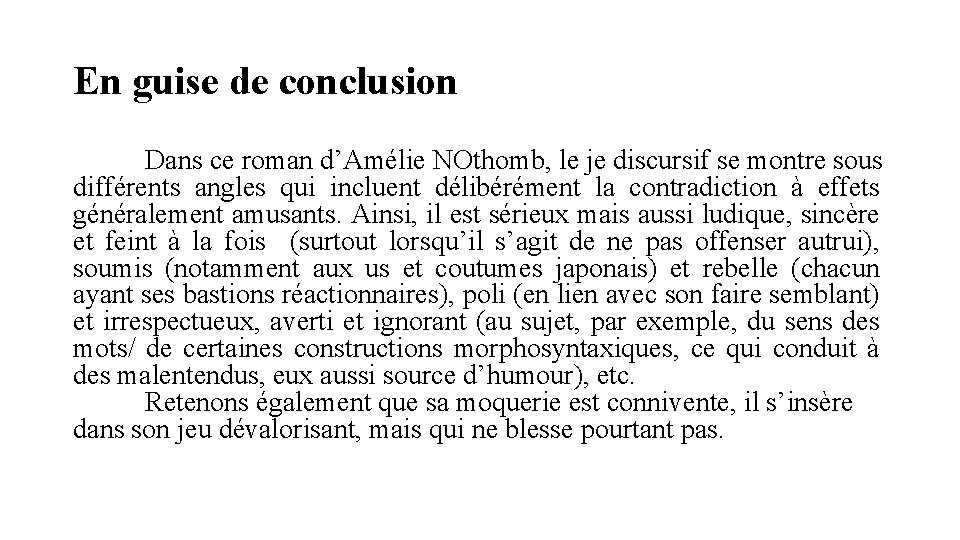






- Slides: 30
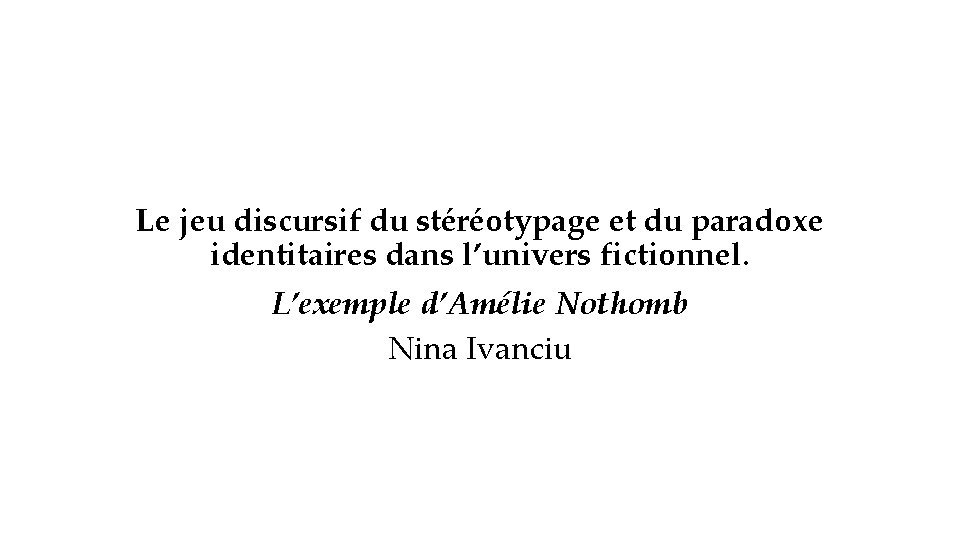
Le jeu discursif du stéréotypage et du paradoxe identitaires dans l’univers fictionnel. L’exemple d’Amélie Nothomb Nina Ivanciu
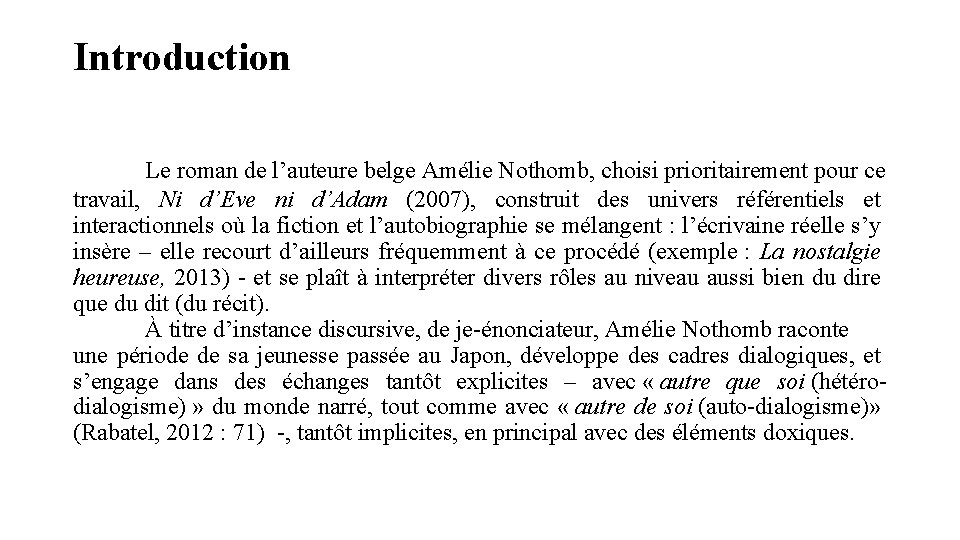
Introduction Le roman de l’auteure belge Amélie Nothomb, choisi prioritairement pour ce travail, Ni d’Eve ni d’Adam (2007), construit des univers référentiels et interactionnels où la fiction et l’autobiographie se mélangent : l’écrivaine réelle s’y insère – elle recourt d’ailleurs fréquemment à ce procédé (exemple : La nostalgie heureuse, 2013) - et se plaît à interpréter divers rôles au niveau aussi bien du dire que du dit (du récit). À titre d’instance discursive, de je-énonciateur, Amélie Nothomb raconte une période de sa jeunesse passée au Japon, développe des cadres dialogiques, et s’engage dans des échanges tantôt explicites – avec « autre que soi (hétérodialogisme) » du monde narré, tout comme avec « autre de soi (auto-dialogisme)» (Rabatel, 2012 : 71) -, tantôt implicites, en principal avec des éléments doxiques.
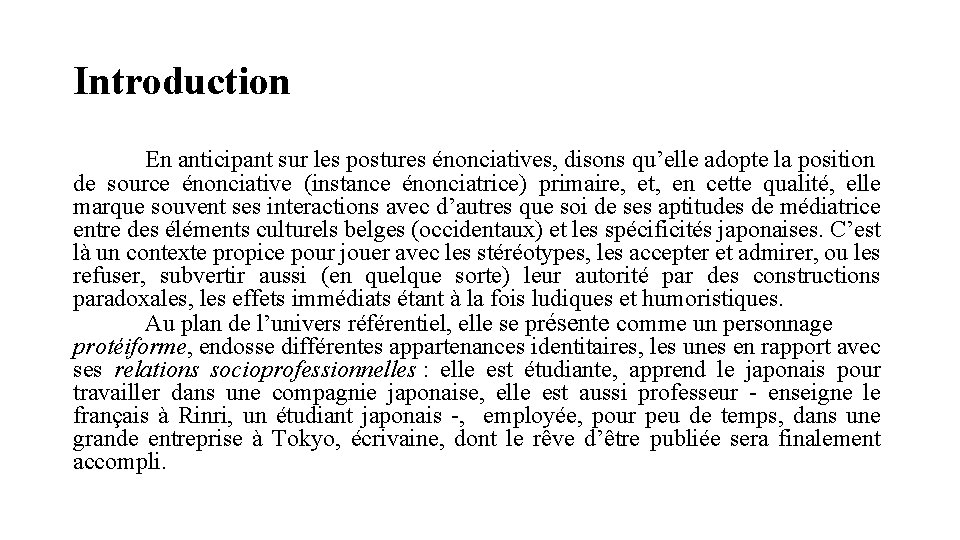
Introduction En anticipant sur les postures énonciatives, disons qu’elle adopte la position de source énonciative (instance énonciatrice) primaire, et, en cette qualité, elle marque souvent ses interactions avec d’autres que soi de ses aptitudes de médiatrice entre des éléments culturels belges (occidentaux) et les spécificités japonaises. C’est là un contexte propice pour jouer avec les stéréotypes, les accepter et admirer, ou les refuser, subvertir aussi (en quelque sorte) leur autorité par des constructions paradoxales, les effets immédiats étant à la fois ludiques et humoristiques. Au plan de l’univers référentiel, elle se présente comme un personnage protéiforme, endosse différentes appartenances identitaires, les unes en rapport avec ses relations socioprofessionnelles : elle est étudiante, apprend le japonais pour travailler dans une compagnie japonaise, elle est aussi professeur - enseigne le français à Rinri, un étudiant japonais -, employée, pour peu de temps, dans une grande entreprise à Tokyo, écrivaine, dont le rêve d’être publiée sera finalement accompli.
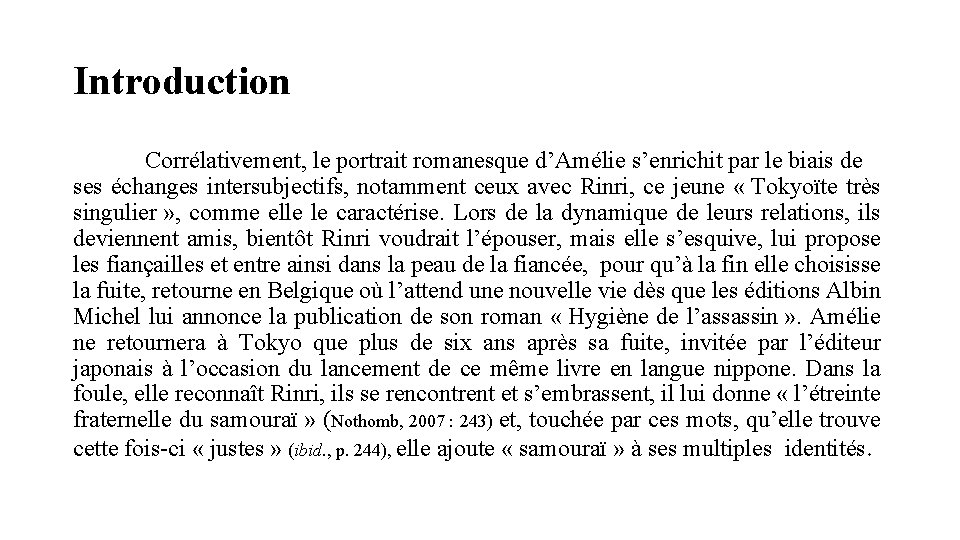
Introduction Corrélativement, le portrait romanesque d’Amélie s’enrichit par le biais de ses échanges intersubjectifs, notamment ceux avec Rinri, ce jeune « Tokyoïte très singulier » , comme elle le caractérise. Lors de la dynamique de leurs relations, ils deviennent amis, bientôt Rinri voudrait l’épouser, mais elle s’esquive, lui propose les fiançailles et entre ainsi dans la peau de la fiancée, pour qu’à la fin elle choisisse la fuite, retourne en Belgique où l’attend une nouvelle vie dès que les éditions Albin Michel lui annonce la publication de son roman « Hygiène de l’assassin » . Amélie ne retournera à Tokyo que plus de six ans après sa fuite, invitée par l’éditeur japonais à l’occasion du lancement de ce même livre en langue nippone. Dans la foule, elle reconnaît Rinri, ils se rencontrent et s’embrassent, il lui donne « l’étreinte fraternelle du samouraï » (Nothomb, 2007 : 243) et, touchée par ces mots, qu’elle trouve cette fois-ci « justes » (ibid. , p. 244), elle ajoute « samouraï » à ses multiples identités.
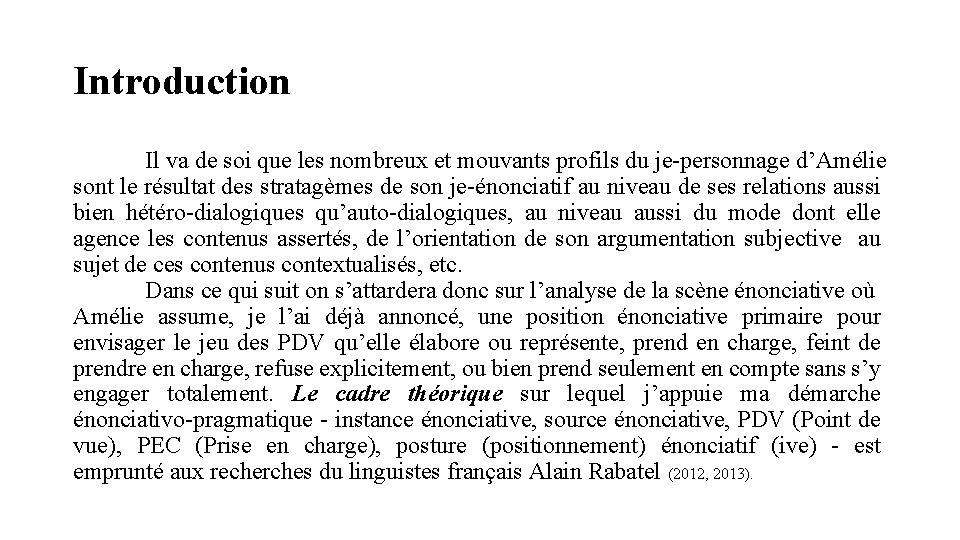
Introduction Il va de soi que les nombreux et mouvants profils du je-personnage d’Amélie sont le résultat des stratagèmes de son je-énonciatif au niveau de ses relations aussi bien hétéro-dialogiques qu’auto-dialogiques, au niveau aussi du mode dont elle agence les contenus assertés, de l’orientation de son argumentation subjective au sujet de ces contenus contextualisés, etc. Dans ce qui suit on s’attardera donc sur l’analyse de la scène énonciative où Amélie assume, je l’ai déjà annoncé, une position énonciative primaire pour envisager le jeu des PDV qu’elle élabore ou représente, prend en charge, feint de prendre en charge, refuse explicitement, ou bien prend seulement en compte sans s’y engager totalement. Le cadre théorique sur lequel j’appuie ma démarche énonciativo-pragmatique - instance énonciative, source énonciative, PDV (Point de vue), PEC (Prise en charge), posture (positionnement) énonciatif (ive) - est emprunté aux recherches du linguistes français Alain Rabatel (2012, 2013).
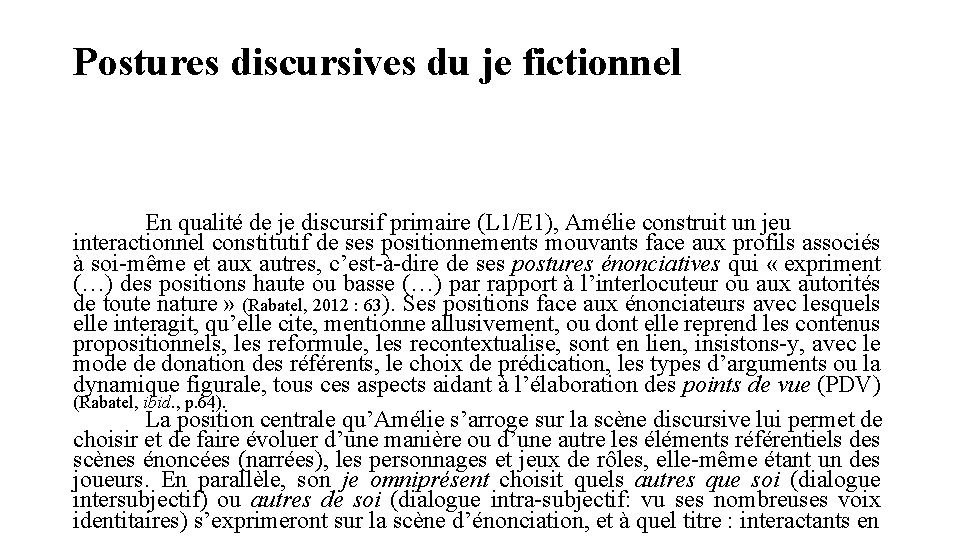
Postures discursives du je fictionnel En qualité de je discursif primaire (L 1/E 1), Amélie construit un jeu interactionnel constitutif de ses positionnements mouvants face aux profils associés à soi-même et aux autres, c’est-à-dire de ses postures énonciatives qui « expriment (…) des positions haute ou basse (…) par rapport à l’interlocuteur ou aux autorités de toute nature » (Rabatel, 2012 : 63). Ses positions face aux énonciateurs avec lesquels elle interagit, qu’elle cite, mentionne allusivement, ou dont elle reprend les contenus propositionnels, les reformule, les recontextualise, sont en lien, insistons-y, avec le mode de donation des référents, le choix de prédication, les types d’arguments ou la dynamique figurale, tous ces aspects aidant à l’élaboration des points de vue (PDV) (Rabatel, ibid. , p. 64). La position centrale qu’Amélie s’arroge sur la scène discursive lui permet de choisir et de faire évoluer d’une manière ou d’une autre les éléments référentiels des scènes énoncées (narrées), les personnages et jeux de rôles, elle-même étant un des joueurs. En parallèle, son je omniprésent choisit quels autres que soi (dialogue intersubjectif) ou autres de soi (dialogue intra-subjectif: vu ses nombreuses voix identitaires) s’exprimeront sur la scène d’énonciation, et à quel titre : interactants en
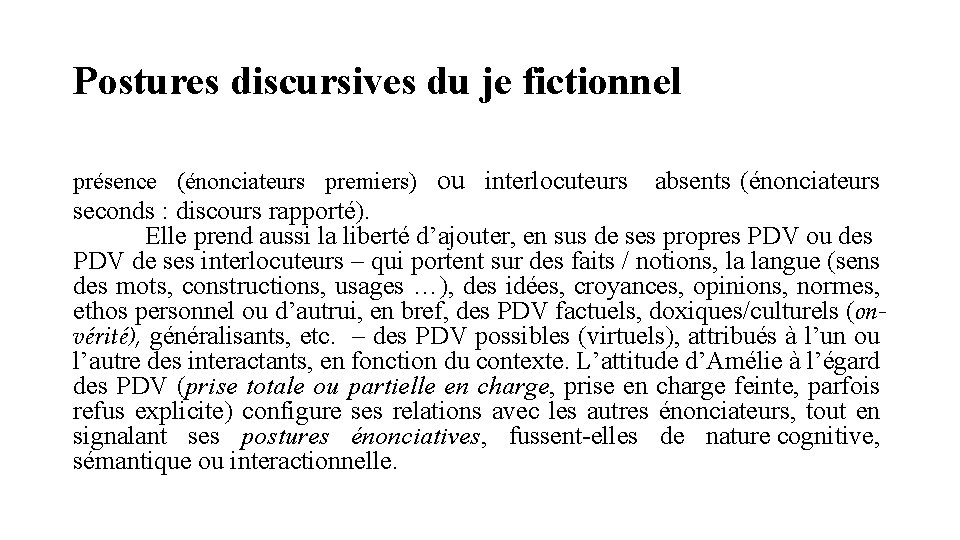
Postures discursives du je fictionnel présence (énonciateurs premiers) ou interlocuteurs absents (énonciateurs seconds : discours rapporté). Elle prend aussi la liberté d’ajouter, en sus de ses propres PDV ou des PDV de ses interlocuteurs – qui portent sur des faits / notions, la langue (sens des mots, constructions, usages …), des idées, croyances, opinions, normes, ethos personnel ou d’autrui, en bref, des PDV factuels, doxiques/culturels (onvérité), généralisants, etc. – des PDV possibles (virtuels), attribués à l’un ou l’autre des interactants, en fonction du contexte. L’attitude d’Amélie à l’égard des PDV (prise totale ou partielle en charge, prise en charge feinte, parfois refus explicite) configure ses relations avec les autres énonciateurs, tout en signalant ses postures énonciatives, fussent-elles de nature cognitive, sémantique ou interactionnelle.
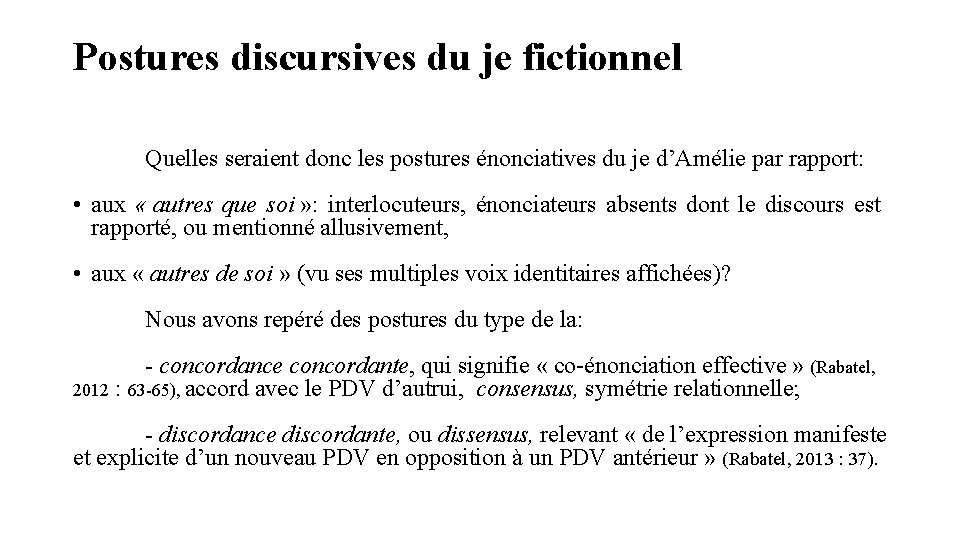
Postures discursives du je fictionnel Quelles seraient donc les postures énonciatives du je d’Amélie par rapport: • aux « autres que soi » : interlocuteurs, énonciateurs absents dont le discours est rapporté, ou mentionné allusivement, • aux « autres de soi » (vu ses multiples voix identitaires affichées)? Nous avons repéré des postures du type de la: - concordance concordante, qui signifie « co-énonciation effective » (Rabatel, 2012 : 63 -65), accord avec le PDV d’autrui, consensus, symétrie relationnelle; - discordance discordante, ou dissensus, relevant « de l’expression manifeste et explicite d’un nouveau PDV en opposition à un PDV antérieur » (Rabatel, 2013 : 37).
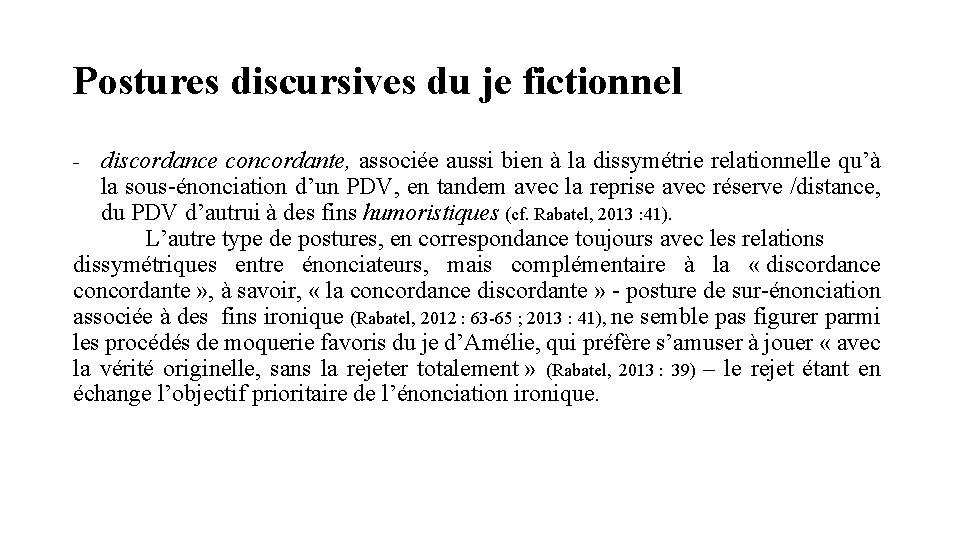
Postures discursives du je fictionnel discordance concordante, associée aussi bien à la dissymétrie relationnelle qu’à la sous-énonciation d’un PDV, en tandem avec la reprise avec réserve /distance, du PDV d’autrui à des fins humoristiques (cf. Rabatel, 2013 : 41). L’autre type de postures, en correspondance toujours avec les relations dissymétriques entre énonciateurs, mais complémentaire à la « discordance concordante » , à savoir, « la concordance discordante » - posture de sur-énonciation associée à des fins ironique (Rabatel, 2012 : 63 -65 ; 2013 : 41), ne semble pas figurer parmi les procédés de moquerie favoris du je d’Amélie, qui préfère s’amuser à jouer « avec la vérité originelle, sans la rejeter totalement » (Rabatel, 2013 : 39) – le rejet étant en échange l’objectif prioritaire de l’énonciation ironique. -
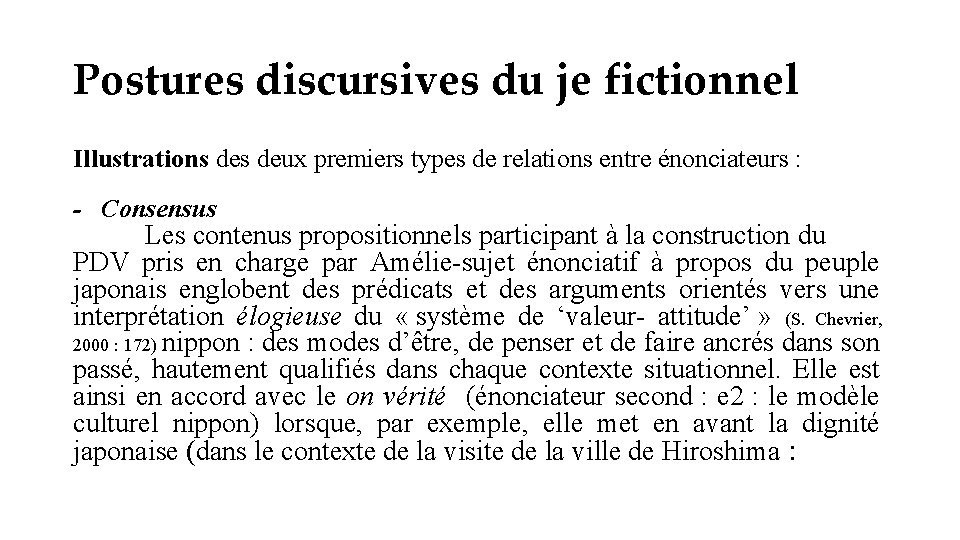
Postures discursives du je fictionnel Illustrations deux premiers types de relations entre énonciateurs : - Consensus Les contenus propositionnels participant à la construction du PDV pris en charge par Amélie-sujet énonciatif à propos du peuple japonais englobent des prédicats et des arguments orientés vers une interprétation élogieuse du « système de ‘valeur- attitude’ » (S. Chevrier, 2000 : 172) nippon : des modes d’être, de penser et de faire ancrés dans son passé, hautement qualifiés dans chaque contexte situationnel. Elle est ainsi en accord avec le on vérité (énonciateur second : e 2 : le modèle culturel nippon) lorsque, par exemple, elle met en avant la dignité japonaise (dans le contexte de la visite de la ville de Hiroshima :
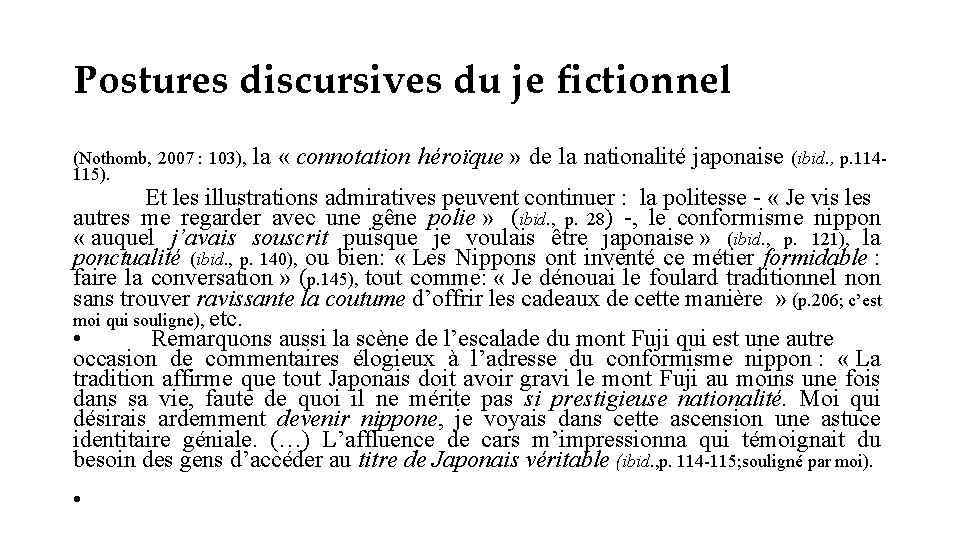
Postures discursives du je fictionnel (Nothomb, 2007 : 103), la « connotation héroïque » de la nationalité japonaise (ibid. , p. 114115). Et les illustrations admiratives peuvent continuer : la politesse - « Je vis les autres me regarder avec une gêne polie » (ibid. , p. 28) -, le conformisme nippon « auquel j’avais souscrit puisque je voulais être japonaise » (ibid. , p. 121), la ponctualité (ibid. , p. 140), ou bien: « Les Nippons ont inventé ce métier formidable : faire la conversation » (p. 145), tout comme: « Je dénouai le foulard traditionnel non sans trouver ravissante la coutume d’offrir les cadeaux de cette manière » (p. 206; c’est moi qui souligne), etc. • Remarquons aussi la scène de l’escalade du mont Fuji qui est une autre occasion de commentaires élogieux à l’adresse du conformisme nippon : « La tradition affirme que tout Japonais doit avoir gravi le mont Fuji au moins une fois dans sa vie, faute de quoi il ne mérite pas si prestigieuse nationalité. Moi qui désirais ardemment devenir nippone, je voyais dans cette ascension une astuce identitaire géniale. (…) L’affluence de cars m’impressionna qui témoignait du besoin des gens d’accéder au titre de Japonais véritable (ibid. , p. 114 -115; souligné par moi). •
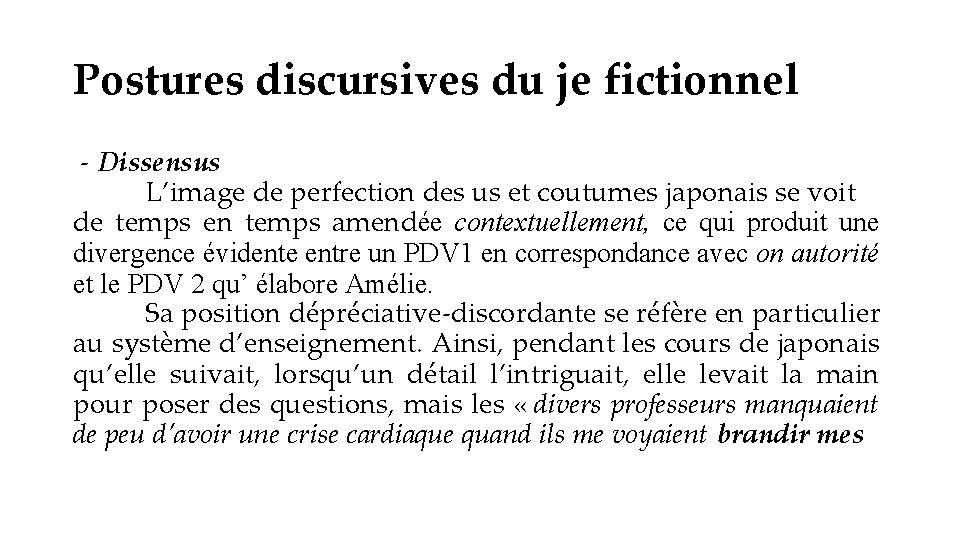
Postures discursives du je fictionnel - Dissensus L’image de perfection des us et coutumes japonais se voit de temps en temps amendée contextuellement, ce qui produit une divergence évidente entre un PDV 1 en correspondance avec on autorité et le PDV 2 qu’ élabore Amélie. Sa position dépréciative-discordante se réfère en particulier au système d’enseignement. Ainsi, pendant les cours de japonais qu’elle suivait, lorsqu’un détail l’intriguait, elle levait la main pour poser des questions, mais les « divers professeurs manquaient de peu d’avoir une crise cardiaque quand ils me voyaient brandir mes
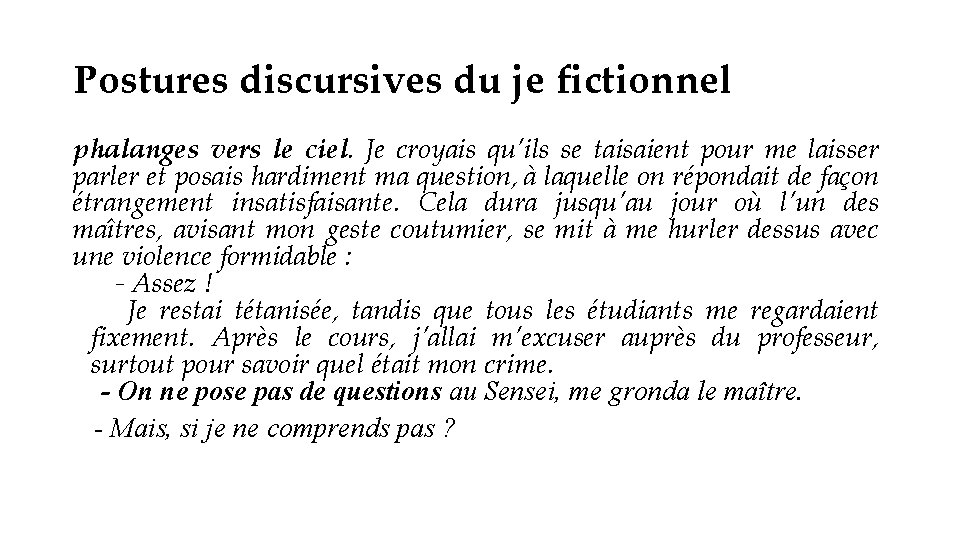
Postures discursives du je fictionnel phalanges vers le ciel. Je croyais qu’ils se taisaient pour me laisser parler et posais hardiment ma question, à laquelle on répondait de façon étrangement insatisfaisante. Cela dura jusqu’au jour où l’un des maîtres, avisant mon geste coutumier, se mit à me hurler dessus avec une violence formidable : - Assez ! Je restai tétanisée, tandis que tous les étudiants me regardaient fixement. Après le cours, j’allai m’excuser auprès du professeur, surtout pour savoir quel était mon crime. - On ne pose pas de questions au Sensei, me gronda le maître. - Mais, si je ne comprends pas ?
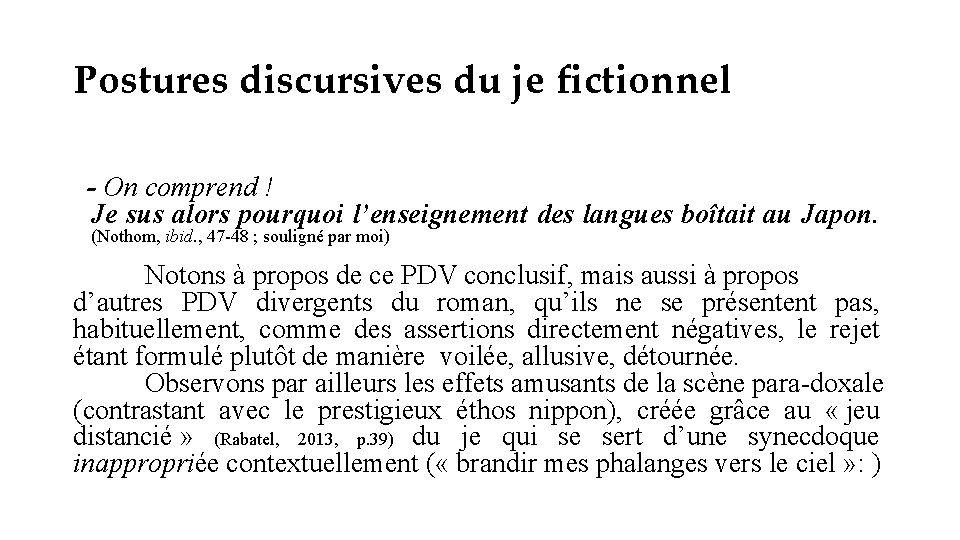
Postures discursives du je fictionnel - On comprend ! Je sus alors pourquoi l’enseignement des langues boîtait au Japon. (Nothom, ibid. , 47 -48 ; souligné par moi) Notons à propos de ce PDV conclusif, mais aussi à propos d’autres PDV divergents du roman, qu’ils ne se présentent pas, habituellement, comme des assertions directement négatives, le rejet étant formulé plutôt de manière voilée, allusive, détournée. Observons par ailleurs les effets amusants de la scène para-doxale (contrastant avec le prestigieux éthos nippon), créée grâce au « jeu distancié » (Rabatel, 2013, p. 39) du je qui se sert d’une synecdoque inappropriée contextuellement ( « brandir mes phalanges vers le ciel » : )
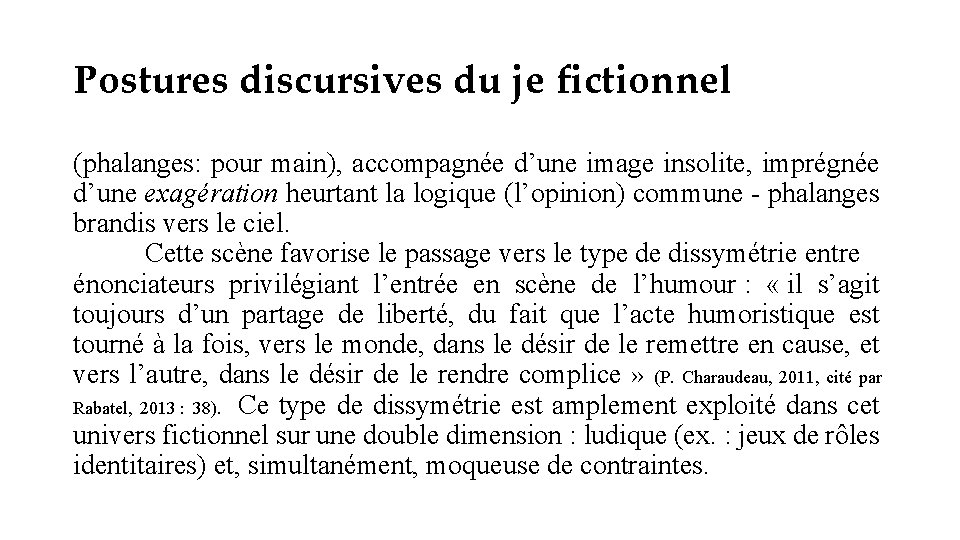
Postures discursives du je fictionnel (phalanges: pour main), accompagnée d’une image insolite, imprégnée d’une exagération heurtant la logique (l’opinion) commune - phalanges brandis vers le ciel. Cette scène favorise le passage vers le type de dissymétrie entre énonciateurs privilégiant l’entrée en scène de l’humour : « il s’agit toujours d’un partage de liberté, du fait que l’acte humoristique est tourné à la fois, vers le monde, dans le désir de le remettre en cause, et vers l’autre, dans le désir de le rendre complice » (P. Charaudeau, 2011, cité par Rabatel, 2013 : 38). Ce type de dissymétrie est amplement exploité dans cet univers fictionnel sur une double dimension : ludique (ex. : jeux de rôles identitaires) et, simultanément, moqueuse de contraintes.
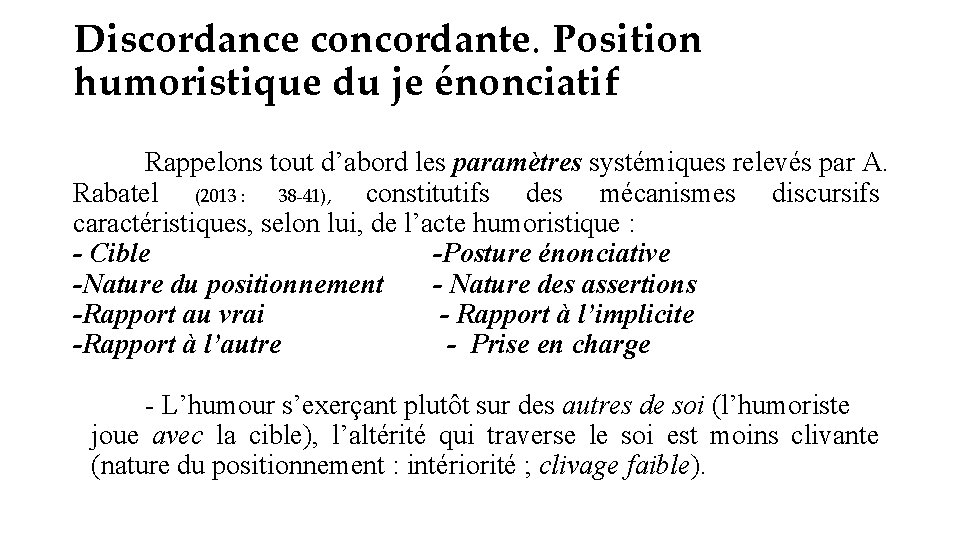
Discordance concordante. Position humoristique du je énonciatif Rappelons tout d’abord les paramètres systémiques relevés par A. Rabatel (2013 : 38 -41), constitutifs des mécanismes discursifs caractéristiques, selon lui, de l’acte humoristique : - Cible -Posture énonciative -Nature du positionnement - Nature des assertions -Rapport au vrai - Rapport à l’implicite -Rapport à l’autre - Prise en charge - L’humour s’exerçant plutôt sur des autres de soi (l’humoriste joue avec la cible), l’altérité qui traverse le soi est moins clivante (nature du positionnement : intériorité ; clivage faible).
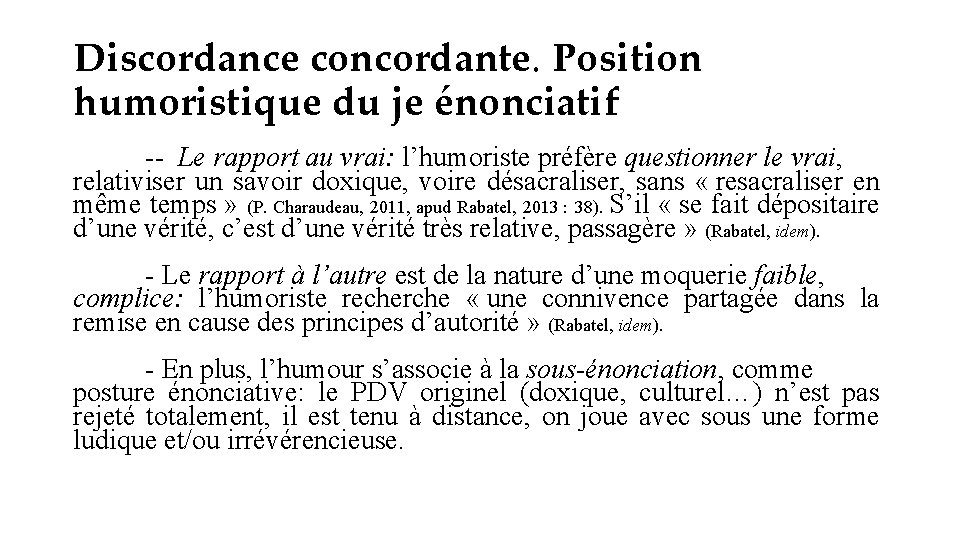
Discordance concordante. Position humoristique du je énonciatif -- Le rapport au vrai: l’humoriste préfère questionner le vrai, relativiser un savoir doxique, voire désacraliser, sans « resacraliser en même temps » (P. Charaudeau, 2011, apud Rabatel, 2013 : 38). S’il « se fait dépositaire d’une vérité, c’est d’une vérité très relative, passagère » (Rabatel, idem). - Le rapport à l’autre est de la nature d’une moquerie faible, complice: l’humoriste recherche « une connivence partagée dans la remise en cause des principes d’autorité » (Rabatel, idem). - En plus, l’humour s’associe à la sous-énonciation, comme posture énonciative: le PDV originel (doxique, culturel…) n’est pas rejeté totalement, il est tenu à distance, on joue avec sous une forme ludique et/ou irrévérencieuse.
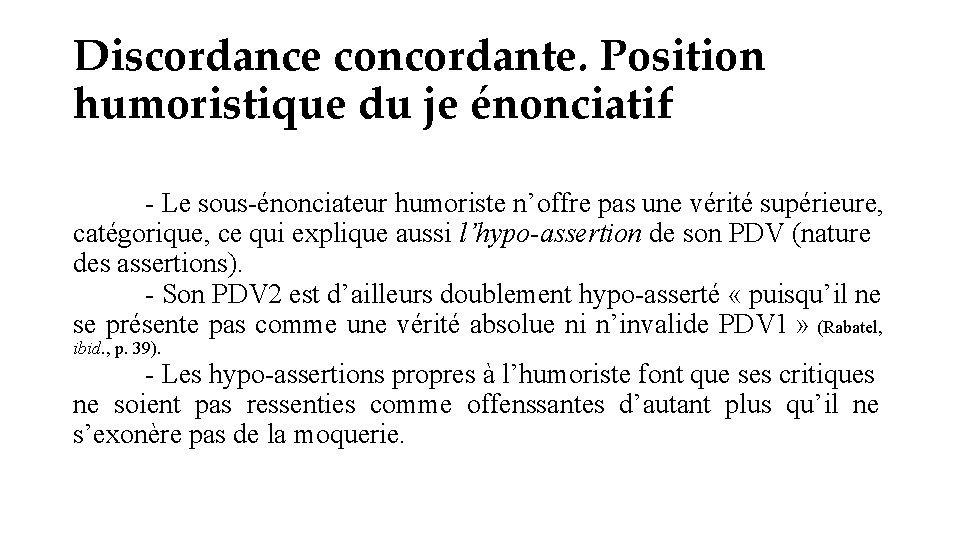
Discordance concordante. Position humoristique du je énonciatif - Le sous-énonciateur humoriste n’offre pas une vérité supérieure, catégorique, ce qui explique aussi l’hypo-assertion de son PDV (nature des assertions). - Son PDV 2 est d’ailleurs doublement hypo-asserté « puisqu’il ne se présente pas comme une vérité absolue ni n’invalide PDV 1 » (Rabatel, ibid. , p. 39). - Les hypo-assertions propres à l’humoriste font que ses critiques ne soient pas ressenties comme offenssantes d’autant plus qu’il ne s’exonère pas de la moquerie.
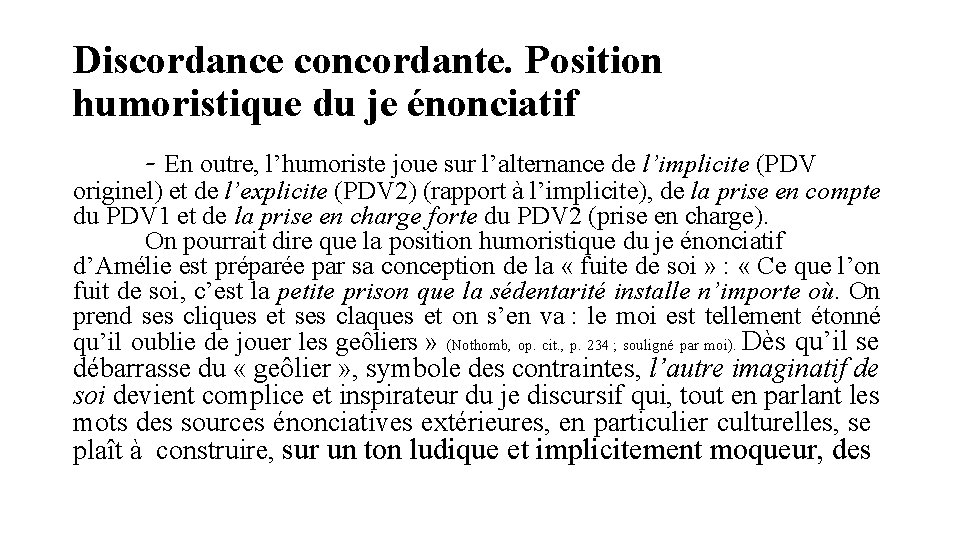
Discordance concordante. Position humoristique du je énonciatif - En outre, l’humoriste joue sur l’alternance de l’implicite (PDV originel) et de l’explicite (PDV 2) (rapport à l’implicite), de la prise en compte du PDV 1 et de la prise en charge forte du PDV 2 (prise en charge). On pourrait dire que la position humoristique du je énonciatif d’Amélie est préparée par sa conception de la « fuite de soi » : « Ce que l’on fuit de soi, c’est la petite prison que la sédentarité installe n’importe où. On prend ses cliques et ses claques et on s’en va : le moi est tellement étonné qu’il oublie de jouer les geôliers » (Nothomb, op. cit. , p. 234 ; souligné par moi). Dès qu’il se débarrasse du « geôlier » , symbole des contraintes, l’autre imaginatif de soi devient complice et inspirateur du je discursif qui, tout en parlant les mots des sources énonciatives extérieures, en particulier culturelles, se plaît à construire, sur un ton ludique et implicitement moqueur, des
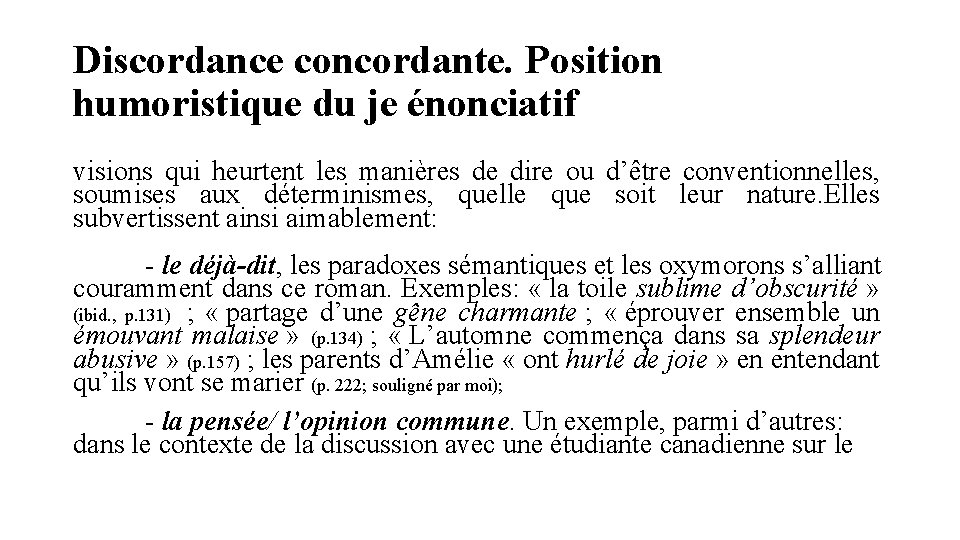
Discordance concordante. Position humoristique du je énonciatif visions qui heurtent les manières de dire ou d’être conventionnelles, soumises aux déterminismes, quelle que soit leur nature. Elles subvertissent ainsi aimablement: - le déjà-dit, les paradoxes sémantiques et les oxymorons s’alliant couramment dans ce roman. Exemples: « la toile sublime d’obscurité » (ibid. , p. 131) ; « partage d’une gêne charmante ; « éprouver ensemble un émouvant malaise » (p. 134) ; « L’automne commença dans sa splendeur abusive » (p. 157) ; les parents d’Amélie « ont hurlé de joie » en entendant qu’ils vont se marier (p. 222; souligné par moi); - la pensée/ l’opinion commune. Un exemple, parmi d’autres: dans le contexte de la discussion avec une étudiante canadienne sur le
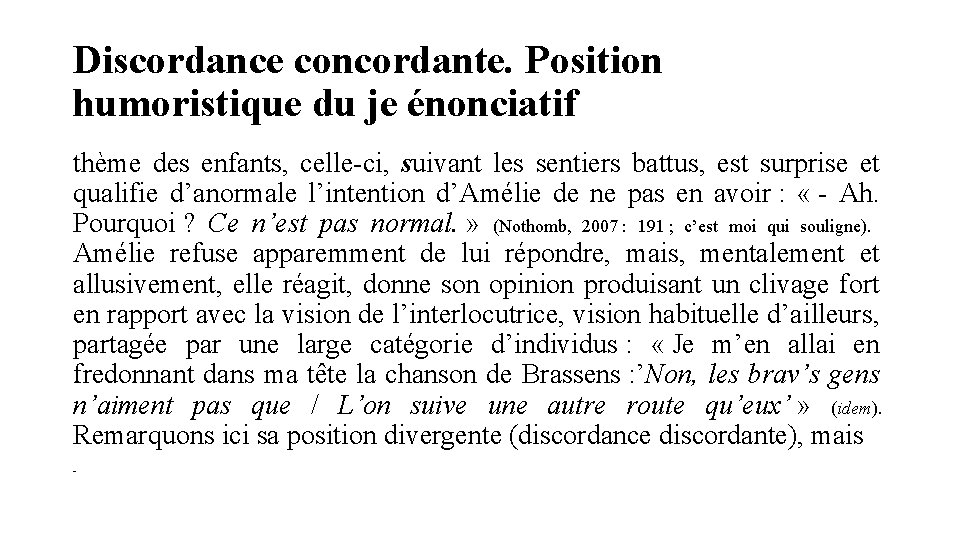
Discordance concordante. Position humoristique du je énonciatif thème des enfants, celle-ci, suivant les sentiers battus, est surprise et qualifie d’anormale l’intention d’Amélie de ne pas en avoir : « - Ah. Pourquoi ? Ce n’est pas normal. » (Nothomb, 2007 : 191 ; c’est moi qui souligne). Amélie refuse apparemment de lui répondre, mais, mentalement et allusivement, elle réagit, donne son opinion produisant un clivage fort en rapport avec la vision de l’interlocutrice, vision habituelle d’ailleurs, partagée par une large catégorie d’individus : « Je m’en allai en fredonnant dans ma tête la chanson de Brassens : ’Non, les brav’s gens n’aiment pas que / L’on suive une autre route qu’eux’ » (idem). Remarquons ici sa position divergente (discordance discordante), mais -
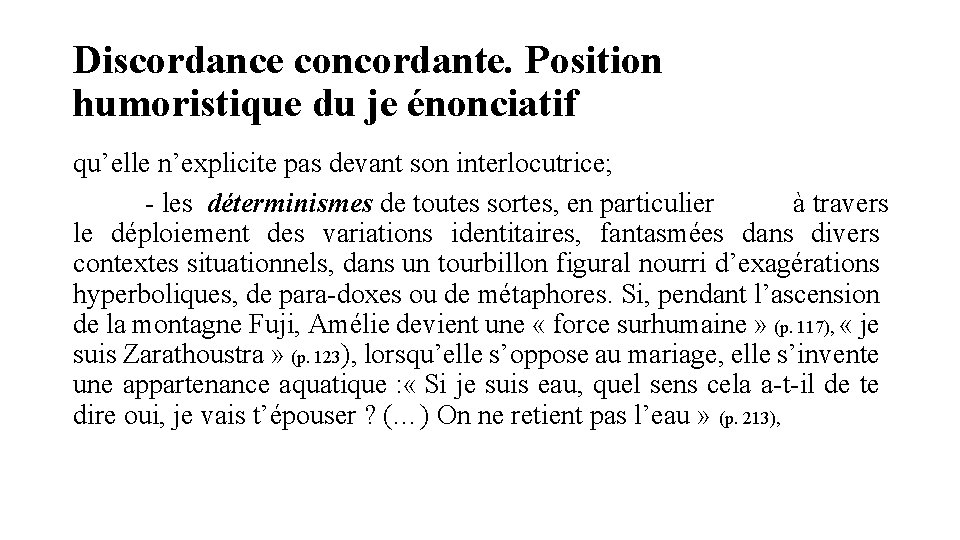
Discordance concordante. Position humoristique du je énonciatif qu’elle n’explicite pas devant son interlocutrice; - les déterminismes de toutes sortes, en particulier à travers le déploiement des variations identitaires, fantasmées dans divers contextes situationnels, dans un tourbillon figural nourri d’exagérations hyperboliques, de para-doxes ou de métaphores. Si, pendant l’ascension de la montagne Fuji, Amélie devient une « force surhumaine » (p. 117), « je suis Zarathoustra » (p. 123), lorsqu’elle s’oppose au mariage, elle s’invente une appartenance aquatique : « Si je suis eau, quel sens cela a-t-il de te dire oui, je vais t’épouser ? (…) On ne retient pas l’eau » (p. 213),
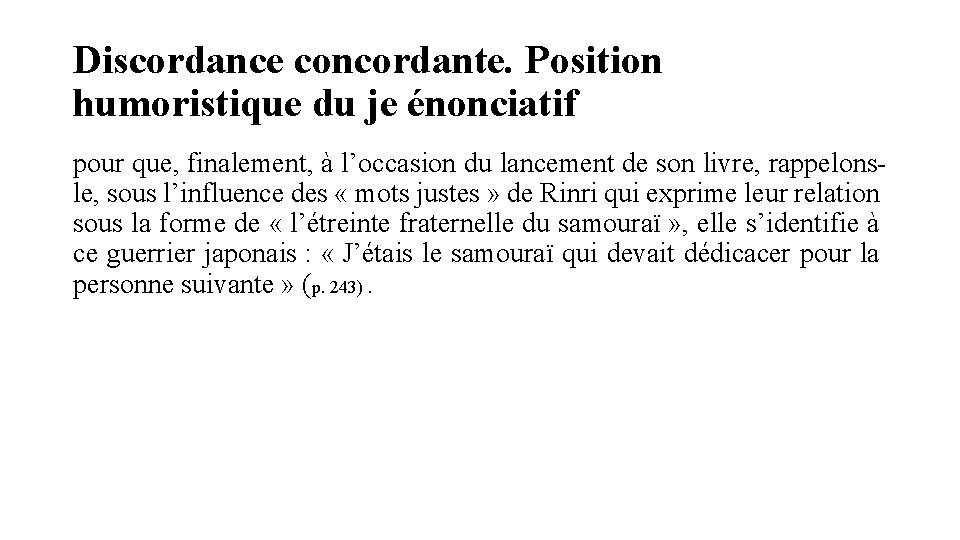
Discordance concordante. Position humoristique du je énonciatif pour que, finalement, à l’occasion du lancement de son livre, rappelonsle, sous l’influence des « mots justes » de Rinri qui exprime leur relation sous la forme de « l’étreinte fraternelle du samouraï » , elle s’identifie à ce guerrier japonais : « J’étais le samouraï qui devait dédicacer pour la personne suivante » (p. 243).
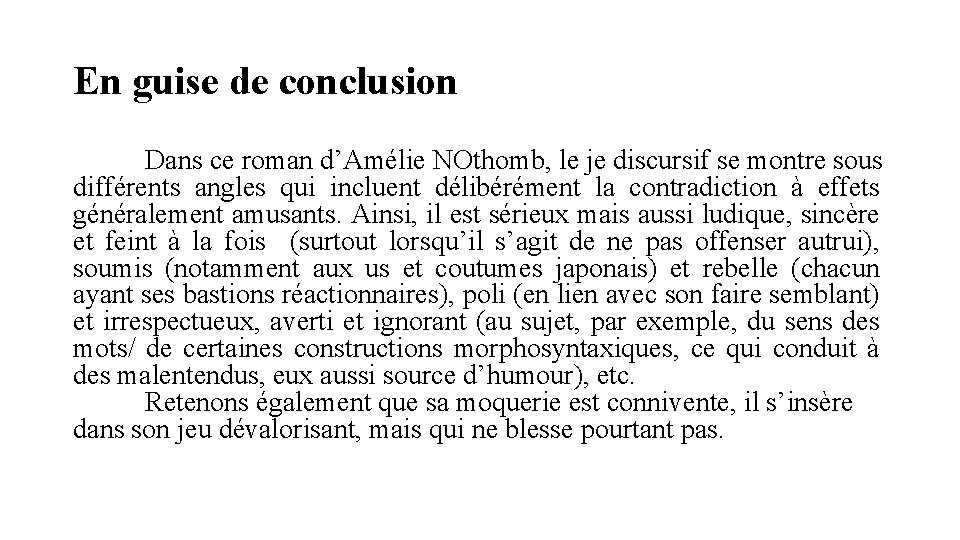
En guise de conclusion Dans ce roman d’Amélie NOthomb, le je discursif se montre sous différents angles qui incluent délibérément la contradiction à effets généralement amusants. Ainsi, il est sérieux mais aussi ludique, sincère et feint à la fois (surtout lorsqu’il s’agit de ne pas offenser autrui), soumis (notamment aux us et coutumes japonais) et rebelle (chacun ayant ses bastions réactionnaires), poli (en lien avec son faire semblant) et irrespectueux, averti et ignorant (au sujet, par exemple, du sens des mots/ de certaines constructions morphosyntaxiques, ce qui conduit à des malentendus, eux aussi source d’humour), etc. Retenons également que sa moquerie est connivente, il s’insère dans son jeu dévalorisant, mais qui ne blesse pourtant pas.





